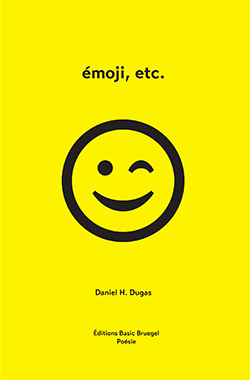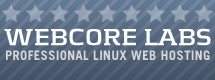Ce que nous voyons, ce qui nous regarde – Georges Didi-Huberman
Compte rendu
Ce que nous voyons, ce que nous regardons
Editions de Minuit, Collection « Critique », Paris, 1992
Mots clés : art, aura, étrangeté, image, jeu, minimalisme, perte, phénoménologie, psychanalyse, présence, scission, tombeau.
Georges Didi-Huberman est philosophe et historien de l’art. Il a publié une trentaine de livres sur la théorie des images en plus de diriger plusieurs expositions. Il enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris.
*
Lorsque nous regardons quelque chose, lorsque nous voyons cette chose, nous ressentons en fait ce qui nous échappe. Voir c’est perdre, voilà l’essentiel du discours de Georges Didi-Huberman[1].
Il est l’auteur du livre Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, un texte extrêmement dense qui s’articule autour des théories de la psychanalyse et de la phénoménologie et qui tente de faire la lumière sur les modalités du visible. Que se passe-t-il lorsque nous « […] posons les yeux sur la mer, un être qui meurt ou bien une œuvre d’art » (p.14)? Ce questionnement, Didi-Huberman le qualifie lui-même « d’obsédant, car […] quand nous voyons ce qui est devant nous, pourquoi quelque chose d’autre toujours nous regarde, à imposer un dans, un dedans? [2]» (p.10).
*
1. L’inéluctable scission du voir
Le titre du premier chapitre annonce un événement qui ne peut être évité. Cette inévitabilité dont parle Didi-Huberman, c’est la scission du voir, c’est-à-dire un éclatement intérieur engendré par l’acte de voir. Pour Sigmund Freud, ce choc est une angoisse, un véritable tremblement de terre dans le cœur de l’homme.
Le livre s’ouvre sur un passage d’Ulysse de James Joyce qui vient fournir plusieurs pistes de réflexion sur l’élaboration de la thèse de Didi-Huberman. L’auteur affirme même que le texte de Joyce « donne […] toutes les composantes théoriques qui font d’un simple plan optique, que nous voyons, une puissance visuelle […] » (p.13). Trois éléments nous intéressent : l’attestation des limites de l’ensemble des mécanismes physiologiques reliés à la vision; l’évocation de la participation d’autres sens que la vision pour voir (le toucher par exemple : « […] voir ne se pense et ne s’éprouve ultimement que dans une expérience du toucher […] » [p.11]) [3] ; et l’importance du jeu rythmique (c’est dans le mouvement, dans les allers-retours entre ce qui est loin et ce qui est proche, entre l’œil et l’objet regardé, que l’image prend forme).
2. L’évitement du vide : croyance ou tautologie
Afin d’illustrer cette angoisse et ce sentiment de perte, Didi-Huberman utilise la « situation exemplaire » (p.17) du tombeau. Cette forme, constituée d’un volume et d’un vide, est le lieu d’une profonde angoisse. Devant un tombeau, nous nous trouvons devant une situation paradoxale. D’un côté, la mort est une expérience commune inscrite dans le parcours de chacun de nous. Mais d’un autre côté, nous sommes incapables de l’expliquer, puisque personne n’en est revenu :
Devant le tombeau je tombe […] dans l’angoisse […]. C’est l’angoisse de regarder au fond – au lieu – de ce qui me regarde, l’angoisse d’être livré à la question de savoir (en fait : de ne pas savoir) ce que devient mon propre corps, entre sa capacité à faire volume et sa capacité à s’offrir au vide, à s’ouvrir. (p.18)
Devant un tel dilemme deux choix s’offrent à nous : celui de l’homme tautologique qui reste en « deçà de la scission » (p.18) et ne voit que ce qu’il voit, ou celui de l’homme de la croyance qui se porte « au-delà de la scission » (p.20) et voit dans le volume et le vide, quelque chose d’autre. Le premier « récuse l’aura dans l’objet » (p. 19) et le second rejette le pouvoir « inquiétant de la mort » (p.20).
3. Le plus simple objet à voir
La vision de l’homme tautologique trouve une mise en œuvre plastique dans le travail des artistes américains des années 60. Le mouvement minimaliste, tel que baptisé par Richard Wollheim, voulait demeurer dans l’expérience du visible tout en offrant un minimum de contenu. Il s’agissait, pour des artistes comme Donald Judd et Robert Morris, d’éliminer toute illusion, tout détail, toute temporalité, tout anthropomorphisme. Il fallait « imposer [les œuvres] comme des objets à voir toujours immédiatement, toujours exactement comme [elles] sont » (p.33), en faire des objets sans aura, des objets qui « ne nous regarde pas » (p.36), des objets spécifiques. Le minimalisme n’aura rien voulu donner à l’homme de la croyance.
4. Le dilemme du visible, ou le jeu des évidences
D’après Didi-Huberman, la rigueur de ce mouvement artistique, qui entendait créer une « présence spécifique », pose problème. L’auteur cite une phrase contradictoire de Donald Judd, dans laquelle ce dernier tente de défendre la simplicité de l’objet minimaliste : « les formes, l’unité […] l’ordre et la couleur sont spécifiques, agressifs, et forts ». Pour Didi-Huberman, comme pour Rosalin Krauss avant lui, cette énonciation successive de qualités, somme toute fort différentes, « évoquerait […] un univers de l’expérience intersubjective donc un enjeu relationnel » (p.38). La « spécificité » même de l’objet, au cœur des motivations minimalistes, s’en trouverait irrémédiablement ébranlée.
Cette contradiction dans le discours de Judd est à l’origine du « dilemme » entre spécificité et présence. Michael Fried, critique d’art moderne et auteur d’un texte célèbre intitulé Art and Objecthood, allait s’opposer à Judd de façon catégorique. Aux yeux de Didi-Huberman, c’est là un faux dilemme « un cercle vicieux, une comédie » (p.49), qui oppose l’évidence optique à l’évidence de la présence. Le vrai problème ne réside, non pas dans ce que nous voyons, ni dans ce qui nous regarde, mais dans l’interstice entre les deux :
Les pensées binaires, les pensées du dilemme sont donc inaptes à saisir quoi que ce soit de l’économie visuelle comme telle. Il n’y a pas à choisir entre ce que nous voyons […] et ce qui nous regarde […]. Il n’y a qu’à s’inquiéter de l’entre. (p.51)
Pour sortir de l’impasse créée par ce faux dilemme, pour « dépasser […] l’opposition du visible et du lisible » (p.85), il faut se concentrer sur la scission elle-même et cela ne peut être fait qu’en dialectisant l’image, c’est-à-dire en dynamisant ses mouvements et ses oppositions.
5. La dialectique du visuel, ou le jeu de l’évidement
Cette dialectique du visuel est examinée à la lumière du jeu de la bobine (ou Fort/Da). Freud observe l’enfant qui joue à lancer son jouet, à le faire disparaître et réapparaître. Cette alternance entre présence et absence reproduirait les tensions du rapport entre l’enfant et sa mère et serait à la source de l’étonnement de l’enfant qui après avoir perdu son jouet, le retrouve comme par magie. Il ne pourrait y avoir d’étonnement sans l’angoisse reliée à la perte.
C’est avec ces fondements théoriques que Didi-Huberman analyse les œuvres d’artistes minimalistes et plus particulièrement celles de l’Américain Tony Smith. Après avoir décrit la genèse, la formalité et la rigueur géométrique des cubes de Smith, l’auteur se demande comment un objet aussi simple qu’un cube se transforme en un objet complexe. La réponse se trouve dans le rapport que le spectateur entretient devant l’objet. Un rapport de jeu qui, à bien des égards, est similaire au jeu de l’enfant et de sa bobine. Un rapport fait d’allers-retours, d’oscillations, d’angoisse et de rire :
Une sculpture de Tony Smith […] serait […] envisageable comme un grand jouet […] permettant d’œuvrer dialectiquement, visuellement, la tragédie du visible et de l’invisible, de l’ouvert et du fermé, de la masse et de l’excavation […] le jeu inventerait un lieu pour l’absence (…) (p.77-78).
6. Anthropomorphisme et dissemblance
Même si les cubes de Tony Smith sont des objets simples, dépourvus de détails, il y a toujours une « inquiétante étrangeté » [4] qui les anime. Elles sont « bien trop géométriques pour ne pas cacher quelque chose comme des entrailles humaines », disait Didi-Huberman (p.88). Il y a dans la réalité de ces sculptures, quelque chose de la réalité humaine, un anthropomorphisme à l’œuvre. L’échelle humaine y joue certainement un rôle déterminant :
[…] le cube devant nous est debout, aussi haut que nous […], mais il est, tout aussi bien, couché; à ce titre, il constitue un lieu dialectique où nous serons peut-être obligés, à force de regarder, de nous imaginer gisant dans cette grande boîte noire (p.94).
Quoi qu’il en soit, l’objet s’est transformé en « quasi-sujet » et possède une « présence ». Le vide à l’intérieur des cubes devient le vide à l’intérieur des hommes. Pour Didi-Huberman, cette double distance est essentielle.
7. La double distance
Walter Benjamin disait de l’aura que c’était « l’unique apparition d’un lointain, si proche qu’elle puisse être » (p.103). Il parlait déjà de la distance et du pouvoir oscillatoire exercé par le regard. Il parlait aussi du pouvoir de la mémoire d’aller au-delà de ce qui est devant nous, de ce que l’on « regarde […] et qui nous échappe […] tout à la fois » (p.104). Si l’expérience auratique a longtemps été reliée au culte, c’est dû à son caractère inapprochable. D’après Didi-Huberman il faudrait séculariser la notion d’aura, la redonner aux hommes, à tous les hommes, car l’expérience humaine, qu’elle soit expérience esthétique ou expérience de la vérité appartient à tout le monde. Il s’agirait en fait de réactualiser l’aura, de créer une nouvelle dimension du sublime.
La notion de distance et de profondeur est une occasion pour Didi-Huberman de réintroduire la phénoménologie de l’aura et de revenir sur les écrits de Merleau-Ponty.
8. L’image critique
Le but de toute image est d’être authentique et elle ne peut accéder à cet état qu’en étant une image dialectique, c’est-à-dire en agitant, en remuant, en bouleversant les sens de l’origine, pour « devenir elle-même […] origine » (p.133). Pour arriver à cette transformation, il doit y avoir un travail critique de la mémoire. Ce n’est qu’à travers celle-ci que l’image dialectique pourra donner « la formulation d’un possible dépassement du dilemme de la croyance et de la tautologie » (p.135). L’image dialectique serait donc « le lieu par excellence où pourrait s’envisager ce qui nous regarde vraiment dans ce que nous voyons » (p.148).
9. Forme et intensité
Afin de résoudre le problème de la forme et de la présence, Didi-Huberman utilise le concept de la « différence »[5] tel que proposé par Jacques Derrida, concept qui « recouvre à la fois le retard d’une “présence toujours différée” et l’espèce de lieu d’origine » (p.156). Ce qu’on entend n’est pas toujours ce qui est écrit et ce que l’on voit n’est pas toujours ce qui est devant nous. En d’autres mots : « l’aura n’est pas un indice d’une présence […], mais l’indice de l’éloignement lui-même, son efficace et son signe à la fois […] » (p.156). Si l’aura est un indice de l’éloignement, elle ne serait que le « simulacre d’une présence » (p157), une trace sujette à s’effacer ou à se « déformer » (p169). Afin d’élucider ce problème, Didi-Huberman retrace les expériences faites par les formalistes russes en soulignant les analogies avec la métapsychologie freudienne et en particulier avec le concept de « l’inquiétante étrangeté » : « cette sorte de l’effrayant qui se rattache aux choses connues depuis longtemps, et de tout temps familières[6] ». L’étrangeté serait de voir ce qui n’est pas énoncé en totalité, un travail de reconstruction fait par la mémoire et le danger le plus grand serait « de risquer de ne plus voir » (p.181), de ne plus exister, de mourir. « L’inquiétante étrangeté » surgit lorsque nous sommes désorientés. C’est cette angoisse qui met en lumière l’expérience de la déchirure, de la perte, c’est elle qui « définit toute notre expérience, quand s’ouvre jusqu’en nous ce qui nous regarde dans ce que nous voyons » (p.185).
10. L’interminable seuil du regard
Le dernier chapitre du livre est étonnant à plusieurs égards. Didi-Huberman remet en scène les James Joyce, Tony Smith, Robert Morris, Walter Benjamin, Franz Kafka et réussit, comme dans un jeu de points à relier, à tracer les contours des « constellations[7] » de l’inquiétude et de l’angoisse humaine.
Nous nous déplaçons alternativement entre la porte de Kafka et les boîtes de Tony Smith, entre le tombeau de l’un et le tombeau de l’autre. Après tout, voilà deux hommes reliés par la tuberculose et l’appréhension de la mort. On pourrait également mettre en relation les boîtes noires de Tony Smith et les téfilines de la religion juive chez Kafka[8].
Qu’est-ce que Didi-Huberman a voulu dire en rédigeant son dernier paragraphe au rythme de L’Ecclésiaste : Un temps pour tout?[9] S’agit-il d’un désir de réancrer le problème de l’aura et de l’objet dans l’expérience spirituelle propre à l’homme ? Suivons la cadence de Didi-Huberman :
[…] un temps pour regarder les choses s’éloigner jusqu’à perte de vue […] un temps pour se sentir perdre le temps jusqu’au temps d’avoir vu le jour […] un temps enfin pour se perdre soi-même […] (p.200)
C’est la même musique qui anime L’Ecclésiaste :
Il y a temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure :
Temps de naître et temps de mourir,
Temps de tuer, temps de guérir,
Temps de planter, temps de détruire […]
Rappelons que L’Ecclésiaste est un texte qui parle de la brièveté de la vie, mais qui insiste surtout sur l’inévitabilité de la mort. C’est une réflexion sur la plus grande angoisse humaine, celle de disparaître : « car il n’y aura ni activité, ni pensée, ni savoir, ni sagesse dans le schéol vers lequel se dirigent tous tes pas[10] ».
Dans un dernier soubresaut d’illumination — portes tournantes, boucles du sens —, Didi-Huberman évoque à nouveau l’imago[11], le concept d’image qui est aussi une effigie funéraire romaine. Il serait difficile de ne pas superposer la multitude de sens de cet imago : l’image, l’effigie, mais aussi la transformation biologique — presque une réincarnation (insecte) —, la transformation psychologique et physique (la métamorphose de Kafka) et le sens que lui donne la psychanalyse (figure archétypale chez Jung et modèle chez Freud). Le texte, et toutes les couches de sens qu’il contient, semble gagner lui aussi en vitalité. En guise de conclusion, Didi-Huberman affirme, comme à la fin d’un long voyage : « [e]t tout cela, pour finir par être soi-même une image » (p.200).
*
Daniel Dugas a travaillé pendant une dizaine d’années sur ses propres cubes, créant tour à tour Le Cube-Aleph[12] (1984-1985), un grand cube inspiré de la nouvelle de Borges L’Aleph et de la notion d’infini énoncé dans le théorème de Cantor; Erica, les boîtes noires[13] (1988); La Boîte rouge[14] (1989); Cowboy-Caruso[15] (1990) et La Nouvelle boîte de Pandore[16] (1991). Depuis 1991, il se consacre à la production vidéographique et à l’écriture.
Daniel Dugas, le 30 avril 2013
![]()
PDF (266 kb)
[1] « […] quand voir, c’est sentir que quelque chose inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir c’est perdre », Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, p. 14.
[2] Il serait intéressant de comparer Ce que nous voyons, ce qui nous regarde avec La poétique de l’espace de Gaston Bachelard, en particulier le chapitre intitulé La dialectique du dehors et du dedans.
[3] Cette opération d’organisation des données sensorielles par plusieurs sens s’appelle en fait la phénoménologie, et Didi-Huberman reviendra avec insistance sur l’apport des théories de Merleau-Ponty.
[4] L’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche en allemand) est un concept freudien. L’essai, paru en 1919 analyse le malaise né d’une rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne. [En ligne], Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/L’inquiétante_étrangeté (page consultée le 24 avril 2013).
[5] Concept que les mots et les signes ne peuvent jamais pleinement réaliser de suite ce qu’ils signifient, mais ne peut être définis que par le biais de recours à d’autres termes desquels ils diffèrent. [En ligne], Wikipédia, http://fr.wiktionary.org/wiki/différance (page consultée le 24 avril 2013).
[6] Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté (Das Unheilmliche), 1919, p.7, [en ligne],
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/essais_psychanalyse_appliquee/10_inquietante_etrangete/inquietante_etrangete.pdf (page consultée le 24 avril 2013).
[7] « Auratique, par conséquent, serait l’objet dont l’apparition déploie, au-delà de sa propre visibilité, ce que nous devons nommer ses images, ses images en constellations ou en nuages […] » p.105
[8] Téfiline – aussi appelé Phylactère: Boîte cubique en cuir (noire) contenant quatre versets de la Bible inscrits sur des rouleaux de parchemin, que les Juifs s’attachent au bras et au front pendant la prière du matin. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/Phylactère (page consultée le 24 avril 2013).
[9] L’Ecclésiaste, Un temps pour tout est attribué à Cohélet, le fils de David et roi d’Israël à Jérusalem.Traduit de l’hébreu et commenté par Ernest Renan, Arléa, Paris, 1990. D’autres liens pourraient être relevés entre L’Ecclésiaste et Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. On pourrait noter entre autre ce passage dans le premier chapitre : « Tout est difficile à expliquer ; l’homme ne peut rendre compte de rien ; l’œil ne se rassasie pas à force de voir ; l’oreille ne se remplit pas à force d’entendre. »
[10] Id., ibid., chapitre 21. Scheol : Encyclop. t. 5, p. 665b, s.v. enfer: le mot hébreu scheol se prend indifféremment pour le lieu de la sépulture, et pour le lieu de supplice réservé aux réprouvés. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/schéol (page consultée le 24 avril 2013).
[11] « Il était déjà question de cela au Moyen Âge, par exemple, lorsque les théologiens ressentirent la nécessité de distinguer du concept d’image (imago) celui de vestigium : le vestige, la trace, la ruine. » p.14. Pour plus d’informations sur le concept de l’imago voir Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio : [en ligne], http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp?tome=3&partie=1&numPage=393&filtre=imago&nomEntree=IMAGINES%20MAJORUM
[12] Le Cube-Aleph : http://daniel.basicbruegel.com/cube-aleph/
[13] Erica, les boîtes noires : http://daniel.basicbruegel.com/erica/
[14] La Boîte rouge : http://daniel.basicbruegel.com/88/
[15] Cowboy-Caruso : http://daniel.basicbruegel.com/cowboy-caruso-1990/
[16] La Nouvelle boîte de Pandore : http://daniel.basicbruegel.com/la-boite-de-pandore-1991/
Rhétorique de l’image, Roland Barthes
Compte rendu
Rhétorique de l’image, Roland Barthes
Communications, 1964, Volume 4, Issue 4, pp. 40-51
Mots clés : Barthes, image, photographie, Manovich, Marketing, Panzani, publicité, sémiotique
Rhétorique de l’image
Roland Barthe (1915-1980) est un sémiologue et un écrivain français. Il est l’une des grandes figures du mouvement des structuralismes, un courant issu de la linguistique qui envisage la réalité comme un ensemble formel de relations. On lui doit de nombreux ouvrages dont Le degré Zéro de l’écriture (1953), Mythologie (1957), S/Z (1970) ainsi que La Chambre claire : Note sur la photographie (1980). Le texte Rhétorique de l’image a été publié dans la revue Communication en 1964, poursuivant ainsi l’exploration entamée dans Le message photographique (1961) dans lequel l’auteur développait l’idée de la photographie comme un message sans code. [1]
Concepts
D’après Jean-Marie Klinkerberg, la figure rhétorique serait : « […] un dispositif consistant à produire des sens implicites, de telle manière que l’énoncé où on le trouve soit polyphonique. »[2] Ce texte de Roland Barthes est donc une analyse des signes et des sens créés par l’image.
La communication entre les hommes se fait de deux façons : elle peut s’exprimer dans un mode digital, fait de signes et de paroles ou dans un mode analogique, fait de gestes et de postures. On caractérise le premier d’explicite (il est clairement formulé), alors que le deuxième est implicite (son interprétation est sous-entendue). Le message linguistique fait partie du code digital alors que l’image se situe dans le code analogique.
La question posée par Barthes est de savoir si l’image, qui est une représentation analogique de la réalité, peut aussi être un code. Est-ce qu’il existe un système de signes dans l’image ? Questionnement ontologique donc sur l’existence du sens dans l’image : « Comment le sens vient-il à l’image ? Où le sens finit-t-il ? et s’il finit, qu’y a-t-il au-delà ? » Pour répondre à ces questions, l’auteur se propose de faire une « analyse spectrale » des messages contenus dans l’image publicitaire. Une publicité de Panzani, le fabricant de pâte alimentaire le plus connu en France, a été retenue, car ce type d’image s’articule autour d’intentions claires :
[…] en publicité, la signification de l’image est assurément intentionnelle […] l’image publicitaire est franche, ou du moins empathique.
L’image Panzani est tout d’abord perçue par le lecteur qui y voit une multitude de signes. Rappelons que pour le philosophe et sémiologue américain Charles Pierce (1839-1914), le signe est : « Quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. » Le signe que nous percevons est le signifiant alors que sa représentation mentale, le sens qu’on en déduit, est le signifié. Par exemple, les pâtes, le poivron, la tomate et le champignon, dénotés dans l’image Panzani, sont des signifiants et le concept « d’italianité » le signifié. Cette opération de transformation, d’un signe à un symbole, est influencée par le bagage culturel du lecteur. C’est ce savoir qui permet le transfert des couleurs dominantes de l’affiche : le vert, le blanc et le rouge, les couleurs du drapeau italien.
Les trois messages
La publicité Panzani est composée de trois messages : le premier est un message linguistique, le second est un message iconique codé et le troisième est un message iconique non codé.
Le message linguistique est facile à discerner : ce sont les légendes, les étiquettes, etc. Ce message peut avoir une fonction soit d’ancrage, soit de relais. Il fait partie du code de la langue française et vient clarifier la lecture en dirigeant les lecteurs « entre les signifiés de l’image »:
[…] le message linguistique guide non plus l’identification, mais l’interprétation, il constitue une sorte d’étau qui empêche les sens connotés de proliférer soit vers des régions trop individuelles […] soir vers des valeurs dysphoriques […]
Le message iconique codé et le message iconique non codé sont un peu plus difficiles à distinguer, car : « le spectateur reçoit en même temps le message perceptif et le message culturel », c’est-à-dire qu’il perçoit simultanément le message littéral sans code et le message symbolique connoté.
Le message iconique non codé traite de la dénotation de l’image qui se présente devant nous comme une combinaison de signes discontinus : la composition, les couleurs, un filet ouvert qui laisse déborder ses aliments, un poivron, des tomates, un champignon, etc. L’ensemble de ces signes dénote « une fraîcheur des produits », sauf peut-être le champignon qui a une apparence plutôt ratatinée, et fait allusion à quelque chose qui n’est pas exprimé concrètement et qui semble redondant : « ce qui spécifie ce troisième message, c’est en effet que le rapport du signifié et du signifiant est quasi-tautologique. » Ce dernier, le message iconique codé, traite de la signification connotative de l’image, de « l’italianité » des produits (signifié). En effet, il n’y a pas de message linguistique qui vient souligner la qualité italienne de la scène. Ce second sens est provoqué par la simple présence objective des signes non codés.
Le rapport entre les deux messages iconiques est extrêmement important, car d’après Barthes, le message dénoté de la photographie serait le seul à « [posséder] le pouvoir de transmettre l’information (littérale) sans la former à l’aide de signes discontinus et de règles de transformation ». C’est dans cette absence de code que s’articulerait un nouveau code, un nouveau sens. En fait, c’est grâce à la dénotation que le message symbolique peut exister :
[…] des 2 messages iconiques, le premier est en quelque sorte imprimé sur le second : le message littéral apparaît comme le support du message symbolique.
Pour Roland Barthes cet état de fait constitue non seulement « une véritable révolution anthropologique », mais établirait également une « nouvelle catégorie de l’espace-temps ».
Commentaire
Le texte Rhétorique de l’image célébrera en 2014 son 50e anniversaire de publication. Si l’article a marqué son époque, il faut dire que les rapports de l’art et de la technique ont beaucoup évolué depuis les années 60. La photographie nous a permis de voir ce qui était invisible à l’oeil nu et a transformé notre perception de façon radicale (on n’a qu’à penser aux photographies d‘Eadweard Muybridge ou d’Harold Edgerton pour le réaliser). Nicolas Bourriaud, parle de la l’invention de photographie et note la modification des modes de représentation qu’elle a engendrée :
Certaines choses s’avèrent désormais inutiles, mais d’autres deviennent enfin possibles : dans le cas de la photographie, c’est la fonction de représentation réaliste qui se révèle progressivement caduque, tandis que des angles de visions nouveaux se voient légitimés (les cadrages de Degas) et que le mode de fonctionnement de l’appareil photo – la restitution du réel par l’impact lumineux – fonde la pratique picturale des impressionnistes.[3]
Il faudrait également rappeler que ce texte a été écrit quelques années seulement avant l’invention des capteurs photographiques CCD qui sont à la base de la révolution numérique.[4] L’image numérique est une image binaire : un code fait de 0 et de 1. Il y a donc un code, même sous le message iconique non codé. D’après Lev Monovich le principe de transcodage culturel, un mélange de la culture humaine et l’organisation structurelle des ordinateurs, serait la conséquence la plus importante de la numérisation.[5] Cette nouvelle modalité de l’image nous forcerait non seulement à redéfinir le type de structure iconique, mais aussi à préciser le rapport que nous entretenons avec la réalité.
Daniel Dugas, 20 mars 2013
![]() PDF (177kb)
PDF (177kb)
[1] Les numéros de la revue Communications publiés de 1961 à 2009 (n° 1 à 85) sont en ligne et en accès libre sur le portail des revues scientifiques Persée, [en ligne],
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/com, (page consultée le 17 mars 2013).
[2] Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Seuil, Paris, 2000, p. 343.
[3] Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les presses du réel, Paris, 1998, p-67-73.
[4] Le CCD a été inventé en 1969 (en anglais : Charge-Coupled Device), c’est un capteur photosensible convertissant la lumière en valeur numérique directement exploitable par l’ordinateur, qui, dans un appareil photo numérique, capture l’image point par point. Office québécois de la langue française, 1997, [en ligne], http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8393657 (page consultée le 17 mars 2013).
[5] Lev Manovich, The Language of New Medias, Cambridge, MIT Press, 2001 p. 45. Manovich dresse une liste des cinq principes du nouveau statut des médias: représentation numérique, modularité, automatisation, variabilité et transcodage culturel. Version en ligne à accès libre, [en ligne], http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf ,(page consultée le 17 mars 2013).
Daniel H. Dugas
Archives
Blogroll
- A.I.R. Vallauris
- ACAD
- Adobe additional services
- Adobe Creative Cloud
- AIRIE
- Amaas
- Amazon Author Central
- ARTothèque
- Australian Poetry
- Basic Bruegel
- Bitly
- CCCA
- CDBaby
- Cycling 74
- Dissolution
- Éditions Prise de parole
- Emmedia
- eyelevelgallery
- FAVA
- Festival acadien de poésie
- Festival FRYE Festival
- FILE – Electronic Language International Festival
- Freeware list
- Fringe Online
- Galerie Sans Nom
- Gotta Minute Film Festival
- Instants Vidéo
- JUiCYHEADS
- Kindle Direct Publishing
- Klondike Institute of Art and Culture
- La Maison de la poésie de Montréal
- La Maison de la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles
- Laboratorio Arte-Alameda
- Le Centre Jacques Cartier
- Liberated Words
- Maison Internationale de la Poésie – Arthur Haulot
- MediaPackBoard
- Miami Book Fair International
- Monoskop
- Mot Dit
- NSCAD University
- Paved Arts
- PoetryFilm
- Portail des auteurs du Nouveau-Brunswick
- RECF
- Revue Ancrages
- Salon du Livre du Grand Sudbury
- Sculpture Space
- Subtropics.org
- Sydney college for the arts
- The Centre for Contemporary Canadian Art
- The New Gallery
- Trevigliopoesia
- tumbler-documents
- V Tape
- Valerie LeBlanc
- VideoBardo
- Void Network-Κενο Δίκτυο
Categories
- #covidpoèmes
- Advertisement
- AIRIE
- Ancrages
- anthology
- Anthropocene
- Architecture
- Around Osprey
- art
- Article de presse
- arts visuels
- audio
- Australian Poetry
- Basic Bruegel Editions
- Book
- book fair
- Cafe Poet Program
- Ce qu'on emporte avec nous
- Citations gratuites
- Collaboration
- commentaire
- commentary
- Compte rendu
- conférence
- Conservation Foundation of the Gulf Coast
- COVID-19
- Critique littéraire
- culture
- Daniel Dugas
- Design
- Édition Michel-Henri
- Éditions Perce-Neige
- Éloizes
- Emmedia
- emoji etc | émoji etc
- Environnement
- essai
- essay
- Everglades
- Exhibition
- festival
- Festival acadien de poésie
- Festival Frye Festival
- FIPTR
- Flow: Big Waters
- Fundy
- Habitat
- installation
- Instants Vidéo
- interactivity
- journal
- JUiCYHEADS
- Kisii
- L'Esprit du temps
- laptop
- Leaving São Paulo
- lecture
- Livre
- logos
- Magazine
- Miami Book Fair
- Moncton 24
- novel
- OASIS
- oil spill
- perception
- performance
- Photo
- poésie
- Poetic Licence Week
- Poetry
- politics
- politique
- press
- Prise de parole
- Revue Ancrages
- salon du livre
- sculpture
- Sculpture Space
- sound
- Souvenirs
- Spirit of the Time
- Style & Artifacts
- Symposium d'art/nature
- talk
- television
- The New Gallery
- Uncategorized
- Valerie LeBlanc
- vidéo
- vidéopoésie
- Videopoetr/Vidéopoésie
- videopoetry
- visual arts
- What We Take With Us
- youth literature