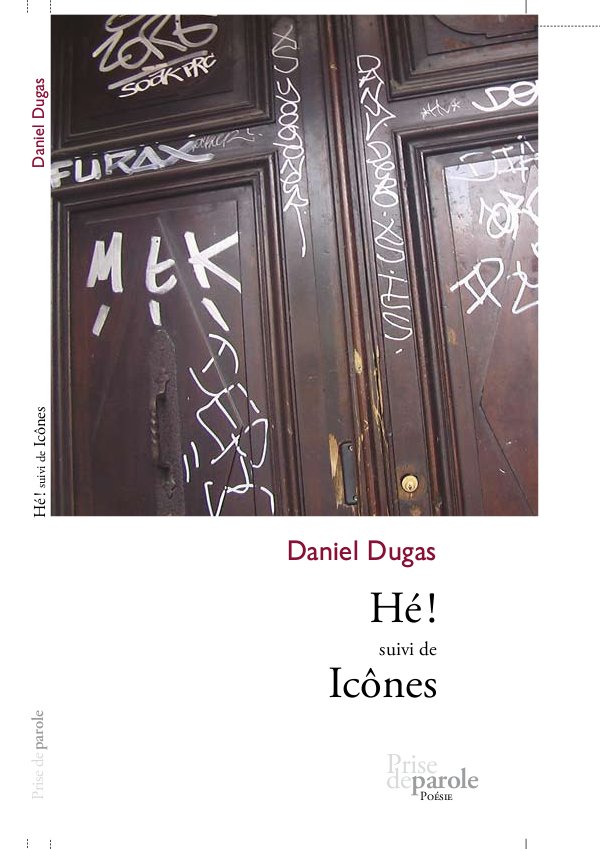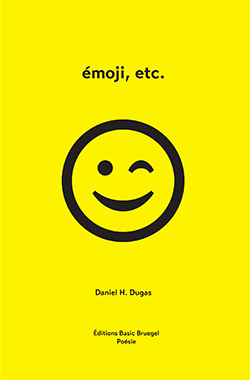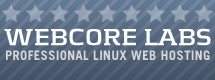Ce que nous voyons, ce qui nous regarde – Georges Didi-Huberman
Compte rendu
Ce que nous voyons, ce que nous regardons
Editions de Minuit, Collection « Critique », Paris, 1992
Mots clés : art, aura, étrangeté, image, jeu, minimalisme, perte, phénoménologie, psychanalyse, présence, scission, tombeau.
Georges Didi-Huberman est philosophe et historien de l’art. Il a publié une trentaine de livres sur la théorie des images en plus de diriger plusieurs expositions. Il enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris.
*
Lorsque nous regardons quelque chose, lorsque nous voyons cette chose, nous ressentons en fait ce qui nous échappe. Voir c’est perdre, voilà l’essentiel du discours de Georges Didi-Huberman[1].
Il est l’auteur du livre Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, un texte extrêmement dense qui s’articule autour des théories de la psychanalyse et de la phénoménologie et qui tente de faire la lumière sur les modalités du visible. Que se passe-t-il lorsque nous « […] posons les yeux sur la mer, un être qui meurt ou bien une œuvre d’art » (p.14)? Ce questionnement, Didi-Huberman le qualifie lui-même « d’obsédant, car […] quand nous voyons ce qui est devant nous, pourquoi quelque chose d’autre toujours nous regarde, à imposer un dans, un dedans? [2]» (p.10).
*
1. L’inéluctable scission du voir
Le titre du premier chapitre annonce un événement qui ne peut être évité. Cette inévitabilité dont parle Didi-Huberman, c’est la scission du voir, c’est-à-dire un éclatement intérieur engendré par l’acte de voir. Pour Sigmund Freud, ce choc est une angoisse, un véritable tremblement de terre dans le cœur de l’homme.
Le livre s’ouvre sur un passage d’Ulysse de James Joyce qui vient fournir plusieurs pistes de réflexion sur l’élaboration de la thèse de Didi-Huberman. L’auteur affirme même que le texte de Joyce « donne […] toutes les composantes théoriques qui font d’un simple plan optique, que nous voyons, une puissance visuelle […] » (p.13). Trois éléments nous intéressent : l’attestation des limites de l’ensemble des mécanismes physiologiques reliés à la vision; l’évocation de la participation d’autres sens que la vision pour voir (le toucher par exemple : « […] voir ne se pense et ne s’éprouve ultimement que dans une expérience du toucher […] » [p.11]) [3] ; et l’importance du jeu rythmique (c’est dans le mouvement, dans les allers-retours entre ce qui est loin et ce qui est proche, entre l’œil et l’objet regardé, que l’image prend forme).
2. L’évitement du vide : croyance ou tautologie
Afin d’illustrer cette angoisse et ce sentiment de perte, Didi-Huberman utilise la « situation exemplaire » (p.17) du tombeau. Cette forme, constituée d’un volume et d’un vide, est le lieu d’une profonde angoisse. Devant un tombeau, nous nous trouvons devant une situation paradoxale. D’un côté, la mort est une expérience commune inscrite dans le parcours de chacun de nous. Mais d’un autre côté, nous sommes incapables de l’expliquer, puisque personne n’en est revenu :
Devant le tombeau je tombe […] dans l’angoisse […]. C’est l’angoisse de regarder au fond – au lieu – de ce qui me regarde, l’angoisse d’être livré à la question de savoir (en fait : de ne pas savoir) ce que devient mon propre corps, entre sa capacité à faire volume et sa capacité à s’offrir au vide, à s’ouvrir. (p.18)
Devant un tel dilemme deux choix s’offrent à nous : celui de l’homme tautologique qui reste en « deçà de la scission » (p.18) et ne voit que ce qu’il voit, ou celui de l’homme de la croyance qui se porte « au-delà de la scission » (p.20) et voit dans le volume et le vide, quelque chose d’autre. Le premier « récuse l’aura dans l’objet » (p. 19) et le second rejette le pouvoir « inquiétant de la mort » (p.20).
3. Le plus simple objet à voir
La vision de l’homme tautologique trouve une mise en œuvre plastique dans le travail des artistes américains des années 60. Le mouvement minimaliste, tel que baptisé par Richard Wollheim, voulait demeurer dans l’expérience du visible tout en offrant un minimum de contenu. Il s’agissait, pour des artistes comme Donald Judd et Robert Morris, d’éliminer toute illusion, tout détail, toute temporalité, tout anthropomorphisme. Il fallait « imposer [les œuvres] comme des objets à voir toujours immédiatement, toujours exactement comme [elles] sont » (p.33), en faire des objets sans aura, des objets qui « ne nous regarde pas » (p.36), des objets spécifiques. Le minimalisme n’aura rien voulu donner à l’homme de la croyance.
4. Le dilemme du visible, ou le jeu des évidences
D’après Didi-Huberman, la rigueur de ce mouvement artistique, qui entendait créer une « présence spécifique », pose problème. L’auteur cite une phrase contradictoire de Donald Judd, dans laquelle ce dernier tente de défendre la simplicité de l’objet minimaliste : « les formes, l’unité […] l’ordre et la couleur sont spécifiques, agressifs, et forts ». Pour Didi-Huberman, comme pour Rosalin Krauss avant lui, cette énonciation successive de qualités, somme toute fort différentes, « évoquerait […] un univers de l’expérience intersubjective donc un enjeu relationnel » (p.38). La « spécificité » même de l’objet, au cœur des motivations minimalistes, s’en trouverait irrémédiablement ébranlée.
Cette contradiction dans le discours de Judd est à l’origine du « dilemme » entre spécificité et présence. Michael Fried, critique d’art moderne et auteur d’un texte célèbre intitulé Art and Objecthood, allait s’opposer à Judd de façon catégorique. Aux yeux de Didi-Huberman, c’est là un faux dilemme « un cercle vicieux, une comédie » (p.49), qui oppose l’évidence optique à l’évidence de la présence. Le vrai problème ne réside, non pas dans ce que nous voyons, ni dans ce qui nous regarde, mais dans l’interstice entre les deux :
Les pensées binaires, les pensées du dilemme sont donc inaptes à saisir quoi que ce soit de l’économie visuelle comme telle. Il n’y a pas à choisir entre ce que nous voyons […] et ce qui nous regarde […]. Il n’y a qu’à s’inquiéter de l’entre. (p.51)
Pour sortir de l’impasse créée par ce faux dilemme, pour « dépasser […] l’opposition du visible et du lisible » (p.85), il faut se concentrer sur la scission elle-même et cela ne peut être fait qu’en dialectisant l’image, c’est-à-dire en dynamisant ses mouvements et ses oppositions.
5. La dialectique du visuel, ou le jeu de l’évidement
Cette dialectique du visuel est examinée à la lumière du jeu de la bobine (ou Fort/Da). Freud observe l’enfant qui joue à lancer son jouet, à le faire disparaître et réapparaître. Cette alternance entre présence et absence reproduirait les tensions du rapport entre l’enfant et sa mère et serait à la source de l’étonnement de l’enfant qui après avoir perdu son jouet, le retrouve comme par magie. Il ne pourrait y avoir d’étonnement sans l’angoisse reliée à la perte.
C’est avec ces fondements théoriques que Didi-Huberman analyse les œuvres d’artistes minimalistes et plus particulièrement celles de l’Américain Tony Smith. Après avoir décrit la genèse, la formalité et la rigueur géométrique des cubes de Smith, l’auteur se demande comment un objet aussi simple qu’un cube se transforme en un objet complexe. La réponse se trouve dans le rapport que le spectateur entretient devant l’objet. Un rapport de jeu qui, à bien des égards, est similaire au jeu de l’enfant et de sa bobine. Un rapport fait d’allers-retours, d’oscillations, d’angoisse et de rire :
Une sculpture de Tony Smith […] serait […] envisageable comme un grand jouet […] permettant d’œuvrer dialectiquement, visuellement, la tragédie du visible et de l’invisible, de l’ouvert et du fermé, de la masse et de l’excavation […] le jeu inventerait un lieu pour l’absence (…) (p.77-78).
6. Anthropomorphisme et dissemblance
Même si les cubes de Tony Smith sont des objets simples, dépourvus de détails, il y a toujours une « inquiétante étrangeté » [4] qui les anime. Elles sont « bien trop géométriques pour ne pas cacher quelque chose comme des entrailles humaines », disait Didi-Huberman (p.88). Il y a dans la réalité de ces sculptures, quelque chose de la réalité humaine, un anthropomorphisme à l’œuvre. L’échelle humaine y joue certainement un rôle déterminant :
[…] le cube devant nous est debout, aussi haut que nous […], mais il est, tout aussi bien, couché; à ce titre, il constitue un lieu dialectique où nous serons peut-être obligés, à force de regarder, de nous imaginer gisant dans cette grande boîte noire (p.94).
Quoi qu’il en soit, l’objet s’est transformé en « quasi-sujet » et possède une « présence ». Le vide à l’intérieur des cubes devient le vide à l’intérieur des hommes. Pour Didi-Huberman, cette double distance est essentielle.
7. La double distance
Walter Benjamin disait de l’aura que c’était « l’unique apparition d’un lointain, si proche qu’elle puisse être » (p.103). Il parlait déjà de la distance et du pouvoir oscillatoire exercé par le regard. Il parlait aussi du pouvoir de la mémoire d’aller au-delà de ce qui est devant nous, de ce que l’on « regarde […] et qui nous échappe […] tout à la fois » (p.104). Si l’expérience auratique a longtemps été reliée au culte, c’est dû à son caractère inapprochable. D’après Didi-Huberman il faudrait séculariser la notion d’aura, la redonner aux hommes, à tous les hommes, car l’expérience humaine, qu’elle soit expérience esthétique ou expérience de la vérité appartient à tout le monde. Il s’agirait en fait de réactualiser l’aura, de créer une nouvelle dimension du sublime.
La notion de distance et de profondeur est une occasion pour Didi-Huberman de réintroduire la phénoménologie de l’aura et de revenir sur les écrits de Merleau-Ponty.
8. L’image critique
Le but de toute image est d’être authentique et elle ne peut accéder à cet état qu’en étant une image dialectique, c’est-à-dire en agitant, en remuant, en bouleversant les sens de l’origine, pour « devenir elle-même […] origine » (p.133). Pour arriver à cette transformation, il doit y avoir un travail critique de la mémoire. Ce n’est qu’à travers celle-ci que l’image dialectique pourra donner « la formulation d’un possible dépassement du dilemme de la croyance et de la tautologie » (p.135). L’image dialectique serait donc « le lieu par excellence où pourrait s’envisager ce qui nous regarde vraiment dans ce que nous voyons » (p.148).
9. Forme et intensité
Afin de résoudre le problème de la forme et de la présence, Didi-Huberman utilise le concept de la « différence »[5] tel que proposé par Jacques Derrida, concept qui « recouvre à la fois le retard d’une “présence toujours différée” et l’espèce de lieu d’origine » (p.156). Ce qu’on entend n’est pas toujours ce qui est écrit et ce que l’on voit n’est pas toujours ce qui est devant nous. En d’autres mots : « l’aura n’est pas un indice d’une présence […], mais l’indice de l’éloignement lui-même, son efficace et son signe à la fois […] » (p.156). Si l’aura est un indice de l’éloignement, elle ne serait que le « simulacre d’une présence » (p157), une trace sujette à s’effacer ou à se « déformer » (p169). Afin d’élucider ce problème, Didi-Huberman retrace les expériences faites par les formalistes russes en soulignant les analogies avec la métapsychologie freudienne et en particulier avec le concept de « l’inquiétante étrangeté » : « cette sorte de l’effrayant qui se rattache aux choses connues depuis longtemps, et de tout temps familières[6] ». L’étrangeté serait de voir ce qui n’est pas énoncé en totalité, un travail de reconstruction fait par la mémoire et le danger le plus grand serait « de risquer de ne plus voir » (p.181), de ne plus exister, de mourir. « L’inquiétante étrangeté » surgit lorsque nous sommes désorientés. C’est cette angoisse qui met en lumière l’expérience de la déchirure, de la perte, c’est elle qui « définit toute notre expérience, quand s’ouvre jusqu’en nous ce qui nous regarde dans ce que nous voyons » (p.185).
10. L’interminable seuil du regard
Le dernier chapitre du livre est étonnant à plusieurs égards. Didi-Huberman remet en scène les James Joyce, Tony Smith, Robert Morris, Walter Benjamin, Franz Kafka et réussit, comme dans un jeu de points à relier, à tracer les contours des « constellations[7] » de l’inquiétude et de l’angoisse humaine.
Nous nous déplaçons alternativement entre la porte de Kafka et les boîtes de Tony Smith, entre le tombeau de l’un et le tombeau de l’autre. Après tout, voilà deux hommes reliés par la tuberculose et l’appréhension de la mort. On pourrait également mettre en relation les boîtes noires de Tony Smith et les téfilines de la religion juive chez Kafka[8].
Qu’est-ce que Didi-Huberman a voulu dire en rédigeant son dernier paragraphe au rythme de L’Ecclésiaste : Un temps pour tout?[9] S’agit-il d’un désir de réancrer le problème de l’aura et de l’objet dans l’expérience spirituelle propre à l’homme ? Suivons la cadence de Didi-Huberman :
[…] un temps pour regarder les choses s’éloigner jusqu’à perte de vue […] un temps pour se sentir perdre le temps jusqu’au temps d’avoir vu le jour […] un temps enfin pour se perdre soi-même […] (p.200)
C’est la même musique qui anime L’Ecclésiaste :
Il y a temps pour tout, et chaque chose sous le ciel a son heure :
Temps de naître et temps de mourir,
Temps de tuer, temps de guérir,
Temps de planter, temps de détruire […]
Rappelons que L’Ecclésiaste est un texte qui parle de la brièveté de la vie, mais qui insiste surtout sur l’inévitabilité de la mort. C’est une réflexion sur la plus grande angoisse humaine, celle de disparaître : « car il n’y aura ni activité, ni pensée, ni savoir, ni sagesse dans le schéol vers lequel se dirigent tous tes pas[10] ».
Dans un dernier soubresaut d’illumination — portes tournantes, boucles du sens —, Didi-Huberman évoque à nouveau l’imago[11], le concept d’image qui est aussi une effigie funéraire romaine. Il serait difficile de ne pas superposer la multitude de sens de cet imago : l’image, l’effigie, mais aussi la transformation biologique — presque une réincarnation (insecte) —, la transformation psychologique et physique (la métamorphose de Kafka) et le sens que lui donne la psychanalyse (figure archétypale chez Jung et modèle chez Freud). Le texte, et toutes les couches de sens qu’il contient, semble gagner lui aussi en vitalité. En guise de conclusion, Didi-Huberman affirme, comme à la fin d’un long voyage : « [e]t tout cela, pour finir par être soi-même une image » (p.200).
*
Daniel Dugas a travaillé pendant une dizaine d’années sur ses propres cubes, créant tour à tour Le Cube-Aleph[12] (1984-1985), un grand cube inspiré de la nouvelle de Borges L’Aleph et de la notion d’infini énoncé dans le théorème de Cantor; Erica, les boîtes noires[13] (1988); La Boîte rouge[14] (1989); Cowboy-Caruso[15] (1990) et La Nouvelle boîte de Pandore[16] (1991). Depuis 1991, il se consacre à la production vidéographique et à l’écriture.
Daniel Dugas, le 30 avril 2013
![]()
PDF (266 kb)
[1] « […] quand voir, c’est sentir que quelque chose inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir c’est perdre », Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, p. 14.
[2] Il serait intéressant de comparer Ce que nous voyons, ce qui nous regarde avec La poétique de l’espace de Gaston Bachelard, en particulier le chapitre intitulé La dialectique du dehors et du dedans.
[3] Cette opération d’organisation des données sensorielles par plusieurs sens s’appelle en fait la phénoménologie, et Didi-Huberman reviendra avec insistance sur l’apport des théories de Merleau-Ponty.
[4] L’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche en allemand) est un concept freudien. L’essai, paru en 1919 analyse le malaise né d’une rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne. [En ligne], Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/L’inquiétante_étrangeté (page consultée le 24 avril 2013).
[5] Concept que les mots et les signes ne peuvent jamais pleinement réaliser de suite ce qu’ils signifient, mais ne peut être définis que par le biais de recours à d’autres termes desquels ils diffèrent. [En ligne], Wikipédia, http://fr.wiktionary.org/wiki/différance (page consultée le 24 avril 2013).
[6] Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté (Das Unheilmliche), 1919, p.7, [en ligne],
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/essais_psychanalyse_appliquee/10_inquietante_etrangete/inquietante_etrangete.pdf (page consultée le 24 avril 2013).
[7] « Auratique, par conséquent, serait l’objet dont l’apparition déploie, au-delà de sa propre visibilité, ce que nous devons nommer ses images, ses images en constellations ou en nuages […] » p.105
[8] Téfiline – aussi appelé Phylactère: Boîte cubique en cuir (noire) contenant quatre versets de la Bible inscrits sur des rouleaux de parchemin, que les Juifs s’attachent au bras et au front pendant la prière du matin. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/Phylactère (page consultée le 24 avril 2013).
[9] L’Ecclésiaste, Un temps pour tout est attribué à Cohélet, le fils de David et roi d’Israël à Jérusalem.Traduit de l’hébreu et commenté par Ernest Renan, Arléa, Paris, 1990. D’autres liens pourraient être relevés entre L’Ecclésiaste et Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. On pourrait noter entre autre ce passage dans le premier chapitre : « Tout est difficile à expliquer ; l’homme ne peut rendre compte de rien ; l’œil ne se rassasie pas à force de voir ; l’oreille ne se remplit pas à force d’entendre. »
[10] Id., ibid., chapitre 21. Scheol : Encyclop. t. 5, p. 665b, s.v. enfer: le mot hébreu scheol se prend indifféremment pour le lieu de la sépulture, et pour le lieu de supplice réservé aux réprouvés. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, [en ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/schéol (page consultée le 24 avril 2013).
[11] « Il était déjà question de cela au Moyen Âge, par exemple, lorsque les théologiens ressentirent la nécessité de distinguer du concept d’image (imago) celui de vestigium : le vestige, la trace, la ruine. » p.14. Pour plus d’informations sur le concept de l’imago voir Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio : [en ligne], http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp?tome=3&partie=1&numPage=393&filtre=imago&nomEntree=IMAGINES%20MAJORUM
[12] Le Cube-Aleph : http://daniel.basicbruegel.com/cube-aleph/
[13] Erica, les boîtes noires : http://daniel.basicbruegel.com/erica/
[14] La Boîte rouge : http://daniel.basicbruegel.com/88/
[15] Cowboy-Caruso : http://daniel.basicbruegel.com/cowboy-caruso-1990/
[16] La Nouvelle boîte de Pandore : http://daniel.basicbruegel.com/la-boite-de-pandore-1991/
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin
Compte rendu
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin,
dernière version 1939, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000. pp. 269-316
CONTEXTE
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique a été écrit par le philosophe et historien de l’art Walter Benjamin (1892-1939) dans un contexte de tensions politiques et de bouleversements économiques. Le monde occidental a dû faire face, dans un court laps de temps, à une série de crises aux conséquences étendues : la Première Guerre mondiale (1914), la révolution russe (1917), la formation de l’U.R.S.S. (1922), la montée du fascisme (1922), le krach économique (1929), et finalement l’instauration du régime nazi (1933). Alors qu’en 1935 Benjamin écrivait la première version de son essai, les Jeux olympiques de Berlin s’organisaient et la cinéaste Leni Riefenstahl était sur le point de réaliser son célèbre film de propagande Les Dieux du stade (Olympia).
La dernière version de L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique a été rédigée en 1939. L’année suivante, Benjamin se suicidait à la frontière espagnole en tentant de fuir le régime nazi. Le texte a été publié à titre posthume en 1955 et demeure une référence incontournable de l’histoire de l’art.
Reproduction technique
D’après Walter Benjamin, l’oeuvre d’art a toujours été reproductible. L’homme a toujours voulu la reproduire que ce soit pour apprendre (élèves), diffuser (artistes), ou en tirer un profit (marchands). Si les conditions de productions chez les Grecs ne permettaient qu’une reproduction manuelle des œuvres d’art, l’apparition de nouvelles techniques comme la gravure sur bois et la lithographie, puis la photographie et le cinéma ont créé de nouvelles conditions de productions. Ces nouvelles modalités ont transformé le caractère de l’œuvre d’art en la dépouillant de son authenticité, bouleversant du coup notre perception de la réalité.
La première fonction de l’œuvre d’art était d’inspirer le recueillement et « trouvait son expression dans le culte » (p.280). La qualité fondamentale de l’œuvre d’art était d’être unique par rapport à un lieu :
Ce qui fait l’authenticité d’une chose est tout ce qu’elle contient de transmissible par son origine, de sa durée matérielle à son pouvoir de témoignage historique (p.275).
Benjamin introduit ici un concept important, celui de l’aura, qu’il définit comme étant « l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il » (p.278). Cette authenticité est à la source de toute œuvre d’art, c’est le souffle de vie qui émane de la chose, c’est le hic and nunc, ce qui existe ici et maintenant. Et c’est cette couche de sens, cette valeur culturelle, qui disparaît avec la reproduction. Benjamin ne peut être plus clair : […] « à l’époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura » (p.276).
Les nouvelles techniques de reproduction ont amené l’œuvre d’art à « s’émancipe[r] de l’existence parasitaire qui lui était impartie dans le cadre du rituel » (p.281). L’œuvre d’art ne se fonde plus sur le rituel, mais sur la politique. Cette politisation de l’art, il faut le rappeler, est un des fondements de la pensée marxiste et s’oppose à l’esthétisation de l’art telle que préconisée par les fascistes. Ce changement d’origine et d’intention est fondamental à la réception de l’œuvre d’art : magique et secrète, elle devient objective et publique.
La valeur culturelle de l’œuvre d’art s’éclipse peu à peu en faveur d’une valeur d’exposition qui met l’accent sur la nouveauté. Benjamin qualifie ce passage, d’une valeur à une autre, de « bouleversement historique » qui « transforme [rait] le caractère général de l’art » (p.287) et nomme le film comme l’agent d’ébranlement le plus puissant :
Leur agent le plus puissant est le film. Même considérée sous sa forme la plus positive, et précisément sous cette forme, on ne peut saisir la signification sociale du cinéma si l’on néglige son aspect destructeur, son aspect cathartique : la liquidation de la valeur traditionnelle de l’héritage culturel (p.276).
Image cinématographique
Les fondations de l’art sont secouées par l’apparition des nouvelles techniques et plus particulièrement par l’infrastructure[1] du cinéma qui transforme le caractère d’unicité propre à l’œuvre d’art. Contrairement aux formes d’art traditionnelles, les conditions de reproduction du cinéma sont inséparables de sa technique :
On pourrait dire, de façon générale, que la technique de reproduction détache l’objet reproduit du domaine de la tradition. En multipliant les exemplaires, elle substitue à son occurrence unique son existence en série. Et en permettant à la reproduction de s’offrir au récepteur dans la situation où il se trouve, elle actualise l’objet reproduit (p.276).
La représentation schématique et linéaire du processus cinématographique positionne l’appareillage (la caméra, le micro, les projecteurs et la pellicule) entre la performance de l’acteur et le spectateur, soumettant ainsi le performeur à un véritable « test optique ». Ce processus de médiation morcèle l’image, qui devint dès lors « […] détachable, transportable » (p 294). L’acteur doit « agir, avec toute sa personne vivante, mais en renonçant à son aura. Car l’aura est liée à son hic et nunc. Il n’en existe aucune reproduction » (p.291). C’est là le paradoxe du cinéma que d’exiger la reproduction de l’œuvre d’art tout en détruisant l’aura qui s’y rattache. La transformation du cinéma est donc double :
Ce qui caractérise le cinéma n’est pas seulement la manière dont l’homme se présente à l’appareil de prise de vues, c’est aussi la façon dont il se représente, grâce à cet appareil le monde qui l’entoure (p.303).
Cette disparition de l’aura n’est cependant pas une chose négative, c’est grâce à cette absence que le spectateur devient un participant actif[2].
COMMENTAIRES
Walter Benjamin soutient que « le film est la forme d’art qui correspond à la vie de plus en plus dangereuse à laquelle doit face l’homme d’aujourd’hui. Le besoin de s’exposer à des effets-chocs est une adaptation des hommes aux périls qui les menacent » (p.309). Si cette assertion était vraie dans les années trente, nous sommes en droit de nous demander si elle l’est toujours aujourd’hui. Pour y répondre, il faut commencer par identifier le type d’art qui nous ressemble. L’invention qui nous caractérise n’est pas un appareil optique comme la caméra, ni une série de procédés chimiques et mécaniques utilisés pour la gravure, c’est plutôt un système de numération : le code binaire. Comme la photographie et comme le cinéma, la révolution numérique (1980-2000) sera venue bouleverser les modalités des modes de reproduction et nous aura encore une fois forcées à redéfinir les limites de ce qu’on appelle la réalité. Pour amplifier ce que Benjamin disait du cinéma, on pourrait dire : Ce qui caractérise le [numérique] n’est pas seulement la manière dont l’homme se présente à [la technologie], c’est aussi la façon dont il se représente, grâce au [code binaire], le monde qui l’entoure.[3]
L’Office québécois de la langue française définit ainsi le numérique : « ensemble des techniques qui permettent la production, le stockage et le traitement d’informations sous forme binaire »[4] (je souligne). C’est l’organisation binaire qui permet la reproduction illimitée des œuvres d’art, et les enjeux de ce phénomène sont nombreux : réglementation et politiques, piratage informatique et violation du droit d’auteur. Récemment, un jugement d’un tribunal américain donnait gain de cause à la maison d’édition de disques Capitol Records qui soutenait que la firme ReDigi violait ses droits d’auteur. ReDigi, un service infonuagique d’achat et de vente de fichiers musicaux « usagés » soutenait que la réglementation « qui permet la revente sans droit d’auteur de livres d’occasion » devrait s’appliquer à leur entreprise. Les implications de ce jugement sont immenses et pourraient mettre un frein à la revente de musique numérique « d’occasion » [5].
On peut le voir, les conséquences du numérique ne sont pas encore claires, et les défis qu’il présente restent à négocier. Benjamin disait de l’homme qu’il avait toujours voulu reproduire les œuvres d’art, mais il est fort à parier qu’il eût envisagé que les marchands fussent si assoiffés de monopole.
Daniel Dugas, 3 avril 2013
![]() PDF (180kb)
PDF (180kb)
[1] Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, Infrastructure, PHILOS. MARXISTE. Ensemble des forces productives et des rapports de production qui servent de base à l’idéologie et aux instances politiques et juridiques qui la reflètent. [en ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/infrastructure (page consultée le 2 avril 2013).
[2] Sur les transformations et le rôle du spectateur, voir le Théâtre de l’opprimé. Augusto Boal y développa dans les années 70 le concept de spec-tateur, une méthode de théâtre interactif qui transforme le spectateur passif en acteur. [en ligne], http://www.theatredelopprime.com/quinoussommes.html (page consultée le 2 avril 2013).
[3] Ce qui caractérise le cinéma n’est pas seulement la manière dont l’homme se présente à l’appareil de prise de vues, c’est aussi la façon dont il se représente, grâce à cet appareil, le monde qui l’entoure. L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dernière version 1939, Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000. (p. 303).
[4] Office québécois de la langue française, Fiche terminologique de Numérique : [en ligne], http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360889 (page consultée le 2 avril 2013).
[5] « La justice américaine statue contre la revente de musique “d’occasion” en numérique ». Le Monde – Technologies, [en ligne], (Mardi, 2 avril 2013). http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/04/02/la-justice-americaine-statue-contre-la-revente-de-musique-d-occasion-en-numerique_3151661_651865.html (page consultée le 2 avril 2013).
Rhétorique de l’image, Roland Barthes
Compte rendu
Rhétorique de l’image, Roland Barthes
Communications, 1964, Volume 4, Issue 4, pp. 40-51
Mots clés : Barthes, image, photographie, Manovich, Marketing, Panzani, publicité, sémiotique
Rhétorique de l’image
Roland Barthe (1915-1980) est un sémiologue et un écrivain français. Il est l’une des grandes figures du mouvement des structuralismes, un courant issu de la linguistique qui envisage la réalité comme un ensemble formel de relations. On lui doit de nombreux ouvrages dont Le degré Zéro de l’écriture (1953), Mythologie (1957), S/Z (1970) ainsi que La Chambre claire : Note sur la photographie (1980). Le texte Rhétorique de l’image a été publié dans la revue Communication en 1964, poursuivant ainsi l’exploration entamée dans Le message photographique (1961) dans lequel l’auteur développait l’idée de la photographie comme un message sans code. [1]
Concepts
D’après Jean-Marie Klinkerberg, la figure rhétorique serait : « […] un dispositif consistant à produire des sens implicites, de telle manière que l’énoncé où on le trouve soit polyphonique. »[2] Ce texte de Roland Barthes est donc une analyse des signes et des sens créés par l’image.
La communication entre les hommes se fait de deux façons : elle peut s’exprimer dans un mode digital, fait de signes et de paroles ou dans un mode analogique, fait de gestes et de postures. On caractérise le premier d’explicite (il est clairement formulé), alors que le deuxième est implicite (son interprétation est sous-entendue). Le message linguistique fait partie du code digital alors que l’image se situe dans le code analogique.
La question posée par Barthes est de savoir si l’image, qui est une représentation analogique de la réalité, peut aussi être un code. Est-ce qu’il existe un système de signes dans l’image ? Questionnement ontologique donc sur l’existence du sens dans l’image : « Comment le sens vient-il à l’image ? Où le sens finit-t-il ? et s’il finit, qu’y a-t-il au-delà ? » Pour répondre à ces questions, l’auteur se propose de faire une « analyse spectrale » des messages contenus dans l’image publicitaire. Une publicité de Panzani, le fabricant de pâte alimentaire le plus connu en France, a été retenue, car ce type d’image s’articule autour d’intentions claires :
[…] en publicité, la signification de l’image est assurément intentionnelle […] l’image publicitaire est franche, ou du moins empathique.
L’image Panzani est tout d’abord perçue par le lecteur qui y voit une multitude de signes. Rappelons que pour le philosophe et sémiologue américain Charles Pierce (1839-1914), le signe est : « Quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. » Le signe que nous percevons est le signifiant alors que sa représentation mentale, le sens qu’on en déduit, est le signifié. Par exemple, les pâtes, le poivron, la tomate et le champignon, dénotés dans l’image Panzani, sont des signifiants et le concept « d’italianité » le signifié. Cette opération de transformation, d’un signe à un symbole, est influencée par le bagage culturel du lecteur. C’est ce savoir qui permet le transfert des couleurs dominantes de l’affiche : le vert, le blanc et le rouge, les couleurs du drapeau italien.
Les trois messages
La publicité Panzani est composée de trois messages : le premier est un message linguistique, le second est un message iconique codé et le troisième est un message iconique non codé.
Le message linguistique est facile à discerner : ce sont les légendes, les étiquettes, etc. Ce message peut avoir une fonction soit d’ancrage, soit de relais. Il fait partie du code de la langue française et vient clarifier la lecture en dirigeant les lecteurs « entre les signifiés de l’image »:
[…] le message linguistique guide non plus l’identification, mais l’interprétation, il constitue une sorte d’étau qui empêche les sens connotés de proliférer soit vers des régions trop individuelles […] soir vers des valeurs dysphoriques […]
Le message iconique codé et le message iconique non codé sont un peu plus difficiles à distinguer, car : « le spectateur reçoit en même temps le message perceptif et le message culturel », c’est-à-dire qu’il perçoit simultanément le message littéral sans code et le message symbolique connoté.
Le message iconique non codé traite de la dénotation de l’image qui se présente devant nous comme une combinaison de signes discontinus : la composition, les couleurs, un filet ouvert qui laisse déborder ses aliments, un poivron, des tomates, un champignon, etc. L’ensemble de ces signes dénote « une fraîcheur des produits », sauf peut-être le champignon qui a une apparence plutôt ratatinée, et fait allusion à quelque chose qui n’est pas exprimé concrètement et qui semble redondant : « ce qui spécifie ce troisième message, c’est en effet que le rapport du signifié et du signifiant est quasi-tautologique. » Ce dernier, le message iconique codé, traite de la signification connotative de l’image, de « l’italianité » des produits (signifié). En effet, il n’y a pas de message linguistique qui vient souligner la qualité italienne de la scène. Ce second sens est provoqué par la simple présence objective des signes non codés.
Le rapport entre les deux messages iconiques est extrêmement important, car d’après Barthes, le message dénoté de la photographie serait le seul à « [posséder] le pouvoir de transmettre l’information (littérale) sans la former à l’aide de signes discontinus et de règles de transformation ». C’est dans cette absence de code que s’articulerait un nouveau code, un nouveau sens. En fait, c’est grâce à la dénotation que le message symbolique peut exister :
[…] des 2 messages iconiques, le premier est en quelque sorte imprimé sur le second : le message littéral apparaît comme le support du message symbolique.
Pour Roland Barthes cet état de fait constitue non seulement « une véritable révolution anthropologique », mais établirait également une « nouvelle catégorie de l’espace-temps ».
Commentaire
Le texte Rhétorique de l’image célébrera en 2014 son 50e anniversaire de publication. Si l’article a marqué son époque, il faut dire que les rapports de l’art et de la technique ont beaucoup évolué depuis les années 60. La photographie nous a permis de voir ce qui était invisible à l’oeil nu et a transformé notre perception de façon radicale (on n’a qu’à penser aux photographies d‘Eadweard Muybridge ou d’Harold Edgerton pour le réaliser). Nicolas Bourriaud, parle de la l’invention de photographie et note la modification des modes de représentation qu’elle a engendrée :
Certaines choses s’avèrent désormais inutiles, mais d’autres deviennent enfin possibles : dans le cas de la photographie, c’est la fonction de représentation réaliste qui se révèle progressivement caduque, tandis que des angles de visions nouveaux se voient légitimés (les cadrages de Degas) et que le mode de fonctionnement de l’appareil photo – la restitution du réel par l’impact lumineux – fonde la pratique picturale des impressionnistes.[3]
Il faudrait également rappeler que ce texte a été écrit quelques années seulement avant l’invention des capteurs photographiques CCD qui sont à la base de la révolution numérique.[4] L’image numérique est une image binaire : un code fait de 0 et de 1. Il y a donc un code, même sous le message iconique non codé. D’après Lev Monovich le principe de transcodage culturel, un mélange de la culture humaine et l’organisation structurelle des ordinateurs, serait la conséquence la plus importante de la numérisation.[5] Cette nouvelle modalité de l’image nous forcerait non seulement à redéfinir le type de structure iconique, mais aussi à préciser le rapport que nous entretenons avec la réalité.
Daniel Dugas, 20 mars 2013
![]() PDF (177kb)
PDF (177kb)
[1] Les numéros de la revue Communications publiés de 1961 à 2009 (n° 1 à 85) sont en ligne et en accès libre sur le portail des revues scientifiques Persée, [en ligne],
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/com, (page consultée le 17 mars 2013).
[2] Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Seuil, Paris, 2000, p. 343.
[3] Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les presses du réel, Paris, 1998, p-67-73.
[4] Le CCD a été inventé en 1969 (en anglais : Charge-Coupled Device), c’est un capteur photosensible convertissant la lumière en valeur numérique directement exploitable par l’ordinateur, qui, dans un appareil photo numérique, capture l’image point par point. Office québécois de la langue française, 1997, [en ligne], http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8393657 (page consultée le 17 mars 2013).
[5] Lev Manovich, The Language of New Medias, Cambridge, MIT Press, 2001 p. 45. Manovich dresse une liste des cinq principes du nouveau statut des médias: représentation numérique, modularité, automatisation, variabilité et transcodage culturel. Version en ligne à accès libre, [en ligne], http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf ,(page consultée le 17 mars 2013).
Dessins et bulles – Pierre Fresnault-Deruelle
Compte rendu
Dessins et bulles : la bande dessinée comme moyen d’expression
Pierre Fresnault-Deruelle
Collection Thème et Enquêtes, sous la direction de Jean Peytard
Bordas / Paris Bruxelles Montréal, 1972, 96p
Chapitre 5 — Les relations de l’image et du texte
MOTS CLÉS : bande dessinée, texte-image, langage, enseignement, pédagogie
Présentation
Dessins et bulles : la bande dessinée comme moyen d’expression est un livre de Pierre Fresnault-Deruelle publié en 1972 par la maison d’édition française Bordas. Cet éditeur qui se spécialise dans la production de matériel scolaire et de dictionnaires lançait, avec Dessins et bulles, une nouvelle collection intitulée Thèmes et enquêtes. Jean Peytard en assurait la direction.
Pierre Fresnault-Deruelle[1] (1943) est un sémiologue de l’image. C’est un auteur prolifique qui travaille depuis plus de trente ans sur l’image fixe. Il a été l’un des premiers « défenseurs » de la bande dessinée et demeure un des grands spécialistes de l’univers d’Hergé. Il est le fondateur du Musée critique de la Sorbonne (MUCRI), un musée virtuel qui se destine à l’analyse des œuvres plastiques et visuelles (photographie, art plastique et bande dessinée)[2].
Jean Peytard (1924-1999) est un linguiste et un pédagogue français qui a enseigné à l’Université de Besançon. Il est connu pour ses concepts d’altération, de variation et d’évaluation ainsi que pour son approche interdisciplinaire. Un colloque international intitulé « Jean Peytard : syntagmes et entailles » a été présenté à l’Université de Franche-Comté, Besançon au mois de juin 2012.
Le 9e art
Même si la bande dessinée avait déjà en 1972 une longue histoire derrière elle, il a fallu attendre longtemps pour qu’elle soit reconnue comme une forme d’art légitime. La parution de Dessins et Bulles s’insérait dans un mouvement de reconnaissance qui venait concrétiser le passage de la BD à l’âge adulte.
Il faut tout d’abord se remettre dans le contexte de l’époque. Les événements de Mai 68 sont encore frais à la mémoire : un vent de changement souffle sur le monde. La bande dessinée qu’on qualifiait d’art mineur recevait en 1964 ses lettres de noblesse et devenait le 9e art[3]. Quelques années plus tard, soit en 1970, Pierre Fresnault-Deruelle faisait de celle-ci le sujet de sa thèse de doctorat. Elle avait pour titre « Approche sémiotique de la bande dessinée » et étudiait le corpus de l’école de Bruxelles[4]. La légitimité de la bande dessinée n’est plus à défendre aujourd’hui, mais en 1972, ce petit livre venait démontrer l’importance et la complexité de ce genre « tout nouveau »[5]. Cet art, devenu majeur, devait maintenant s’enseigner à l’école.
Dessins et bulles est donc un outil pédagogique qui se propose d’aborder et d’analyser la bande dessinée, son « fonctionnement » et sa « construction ». Le but de Pierre Fresnault-Deruelle et de Jean Peytard (pour ne pas dire le dessein) est de familiariser les élèves et les enseignants à ce genre tout en leur fournissant des outils théoriques et pratiques pour qu’ils puissent analyser le contenu des cartoons :
Notre désir est qu’avec ce petit livre, les élèves et leurs maîtres puissent avoir un instrument à leur service dans l’exploration passionnante de ce moyen d’expression partout présent dans notre vie quotidienne.
Le livre fait tout d’abord un survol historique de la bande dessinée et présente, en dix chapitres, les divers éléments qui la composent : la vignette ; les ballons ; les relations entre le texte et l’image ; le montage ; le scénario ; les héros et le temps et l’espace. Le livre foisonne d’exemples choisis parmi une grande variété de BD, Tintin y fait bonne figure, mais on trouve également Spirou ; les Schtroumpfs ; Gaston Lagaffe ; Prince Vaillant et bien d’autres. Chaque partie est augmentée par une série de travaux pratiques. Les intentions pédagogiques sont à l’avant-plan et l’importance du dialogue et du travail d’équipe est capitale.
Chapitre 5 — Les relations entre le texte et l’image
La bande dessinée est composée de deux messages : un premier iconique et un deuxième linguistique. Il y a, bien sûr, des bandes dessinées sans texte, mais il ne pourrait y avoir de bandes dessinées sans dessins. Lorsque les deux univers se juxtaposent, il se tisse une série de liens très particuliers entre les deux. Ces relations peuvent exister au sein de la vignette elle-même ou s’étendre d’une vignette à l’autre. On pourrait presque qualifier cette relation de symbiotique, puisque chacun des deux codes gagne dans l’échange. Ce qu’un code ne peut traduire l’autre s’en occupe.
Quand l’image apparaît sans texte, elle est polysémique, c’est-à-dire que la qualité du message iconique a plus d’un sens. Lorsque l’image est accompagnée d’un texte, elle est monosémique. Dans ce cas, le texte vient « appauvrir » l’image en lui donnant qu’un seul sens. Cependant, il existe des situations où le dessin est incapable de fournir les informations nécessaires à la compréhension du scénario. Le texte est alors indispensable, le couple inséparable.
Quelquefois l’écriture se fait image, on parle de la fonction imageante du texte. L’utilisation d’onomatopées, abondant dans la BD, fournit un exemple facile à visualiser. Dans d’autres circonstances c’est le dessin qui se fait texte, on parle ici de fonction linguistique de l’image. On pourrait citer des exemples où l’auteur dessine des enseignes, des panneaux, des inscriptions.
Le texte s’inscrit habituellement dans les ballons ou dans les bulles. C’est là que s’expriment les personnages et c’est grâce à ces renseignements que le lecteur peut avancer dans le récit. Le texte a donc une fonction d’ancrage, d’enchaînement, de relais. Fresnault-Deruelle parle de l’effet de lecture comme une « vision-lecture ». Et c’est bien ce que fait la BD, elle transforme le lecteur en trapéziste :
La collection Thèmes et enquêtes se voulait ouverte sur le monde, attentive à l’émergence de nouvelles réalités culturelles. On envisageait de développer d’autres livres sur la science-fiction, la publicité, le langage de la radio et le spectacle télévisuel. Malheureusement, Dessins et bulles fut le premier et le dernier numéro de cette série.
Proposition finale qui dérive d’autres propositions
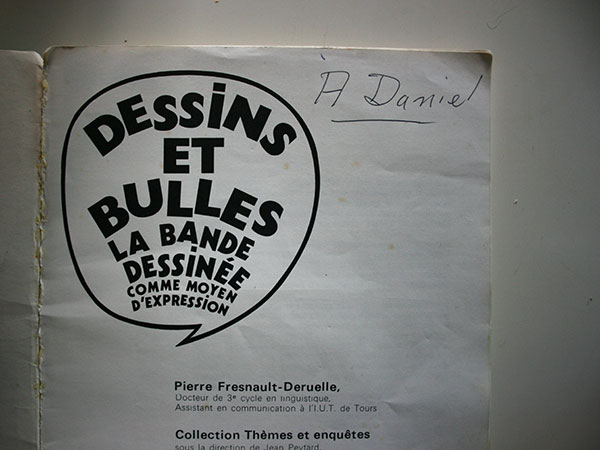
La lecture de Dessins et bulles m’a permis de faire un retour sur ma jeunesse et sur le rêve qui m’habitait à ce moment-là : devenir bédéiste. Après tout, j’étais né la même journée que Pilote[6], mon magazine préféré de bandes dessinées. Lorsque Dessins et Bulles paraît en 1972 mon père me l’offre pour mes douze ans. C’est un cadeau extraordinaire ! Aujourd’hui, quarante ans plus tard, la seule page couverture me rappelle la passion que j’avais pour la BD, et la simple dédicace de mon père, à l’intérieur du livre, demeure un symbole indubitable d’encouragement d’un père pour son fils. Le petit livre vert m’accompagne depuis.
à suivre…
[1] Pour un profil complet, voir le site VISIO de l’Association internationale de sémiotique visuelle. [En ligne] http://www.visio.hst.ulaval.ca/fresnault.htm (Page consultée le 2 mars 2013)
[2] [En ligne] http://mucri.univ-paris1.fr/portail/ (Page consultée le 2 mars 2013)
Le site du Musée critique de la Sorbonne est présentement en reconstruction.
[3] L’expression a été inventée en 1964 par Maurice de Bévère (alias Morris) et Pierre Vankeer. [En ligne] http://fr.wiktionary.org/wiki/neuvième_art (Page consultée le 2 mars 2013)
[4] Le style de l’école de Bruxelles est caractérisé par un dessin réaliste et l’utilisation d’un langage graphique clair. [En ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/École_de_Bruxelles (Page consultée le 2 mars 2013)
[5] Pour se rendre compte du chemin parcouru, voir le programme de maîtrise MLitt in Comics Studies, Université de Dundee en Angleterre : [En ligne] http://www.dundee.ac.uk/english/prospective/postgraduates/comicstudies/ (Page consultée le 2 mars 2013)
[6] 29 octobre 1959. [En ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Pilote_(périodique) (Page consultée le 2 mars 2013)
Propos sur l’écriture et la typographie, Michel Butor
Compte rendu
Propos sur l’écriture et la typographie, Michel Butor
Communication et langages. Nº 13, 1972, pp 5-29
Mots clés : typographie, structure, objet, modulation, mouvement, graphie, lecture
Propos sur l’écriture et la typographie est une transcription de l’enregistrement d’une causerie donnée par Michel Butor dans le cadre des Rencontres Internationales de Lures en 1972. Ces rencontres dédiées au questionnement typographique et à la culture graphique ont été créées en 1952 à l’initiative du théoricien de la typographie française Maximilien Vox.
Michel Butor, un des auteurs associés au Nouveau Roman, est un poète, romancier et essayiste français né en 1926. Son premier roman Passage de Milan a été publié chez Gallimard en 1954. Il rompt avec la forme romanesque en 1960 et publie quelques années plus tard Mobile, étude pour une représentation des États-Unis où il expérimente la mise en espace du texte. Cet auteur expérimental a écrit sur la peinture et a créé avec des peintres plusieurs livres d’artistes. Il vit à Lucinges, près de Genève.
Un lien essentiel
Le lien entre la littérature et la typographie est essentiel, puisque le rôle de la typographie est d’imager le texte, de lui donner un corps. Nous vivons dans des sociétés où le texte et la typographie sont omniprésents. Si nous sommes assaillies par le texte, nous sommes aussi interpellés par la forme qui le soutient. Butor conçoit le texte comme un objet qui aurait un fonctionnement similaire à l’objet symbolique introduit par les surréalistes[1]. C’est-à-dire qu’il ne serait pas là pour sa valeur esthétique, mais pour provoquer un sens nouveau. En disposant les objets / textes sur la page ou dans le livre, Butor met en place un système où le lecteur peut créer son propre sens.
Pour ce faire, il utilise la typographie non-choc, c’est-à-dire une typographie qui se développe sur un mode de lenteur et qui s’oppose à une forme plus rapide, plus brutale, souvent utilisée par la publicité. Son but n’est pas d’épater, mais de donner au lecteur un système et des structures de lecture. Le lecteur pourra faire des choix et recomposer comme il l’entend le texte de départ. Un lecteur curieux pourra donc lire un texte plus complexe qu’un lecteur moins curieux. Butor est toutefois conscient que l’énergie engendrée par cette multitude de possibilités pourrait échapper à certains lecteurs, mais c’est un risque qu’il est prêt à prendre.
« Le mot est visuel aussi »
Le projet de Michel Butor est de réaffirmer la valeur visuelle du texte sans toutefois amoindrir ses qualités auditives. Ses livres, même s’ils ont « un aspect auditif sont toujours mis en relation avec les aspects visuels ». Même le texte radiophonique « lieu d’expérience le plus éloigné du livre » devient pour Butor un défi d’écriture et d’expérimentation visuelle. La stéréophonie d’un texte, comme celui des 6 810 000 litres d’eau par seconde, s’exprime visuellement sur la page avec un dialogue à gauche et un autre à droite. Il est intéressant de noter dans Propos sur l’écriture et la typographie les innombrables retours à l’audible. Butor revient constamment à l’ouïe, à l’audition, à la musique, à la perception des sons. Ce n’est pas une opposition, mais plutôt une affirmation d’une relation intime qui existe entre ces deux modes :
Quant à la question : « Faut-il lire auditivement ou visuellement ? », eh bien ! le développement des techniques audio-visuelles nous montre bien que l’acte de lecture […] était à la fois auditif et visuel. Les deux façons sont toujours liées.
Le type de lecture est influencé par le type de structure du livre. Certains livres sont faits pour être lus d’un bout à l’autre (les romans par exemple), alors que d’autres, plus visuels, ne sont pas faits pour être lus d’un seul trait. Pensons aux dictionnaires, aux guides et même aux annuaires téléphoniques que Butor qualifie de « chef-d’œuvre méconnu de la civilisation occidentale ». Le désir de Michel Butor est de créer à l’intérieur du texte une mobilité, un mouvement, et la typographie est l’instrument privilégié « qui détermine la manière dont l’œil est dirigé dans la page ».
Pour Butor l’écriture est une véritable expérience tridimensionnelle. Elle se compose de trois vecteurs : un premier horizontal, un second vertical et un troisième perpendiculaire. Ces trois axes rappellent les coordonnées du plan, c’est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur. Cette terminologie prend tout son sens lorsqu’on réalise que le « volume » est aussi bien un ouvrage, un texte imprimé qu’une portion de l’espace à trois dimensions : « […] Le livre n’est pas une surface, c’est un volume qui a des propriétés particulières et dont on tourne les pages […] ». Si la coordonnée de la profondeur crée le relief, celle de la perpendicularité créerait une mobilité, une possibilité :
Dans tous mes livres, il y a cette possibilité de mobile littéraire intérieur à la physique du livre et étudié à partir de toutes sortes d’ordres.
Des modulations et de la musique
Butor revient souvent, lorsqu’il parle de l’écriture, à l’analogie de la musique. Il parle du disque, de la radio, de l’opéra, de l’expérience auditive, de la stéréophonie : « […] Je rêve de pouvoir utiliser bien mieux cet « orchestre » dans lequel chaque caractère est un timbre […], il y a là un phénomène comparable à ce qu’on appelle en musique un contrepoint […], j’aurais une accélération du tempo […] », etc. Pour Butor, la typographie est le rythme de l’écriture, elle insuffle un mouvement, elle scande le texte. L’écriture sérielle, des réserves de textes qu’on trouve dans Description de San Marco, ressemble à des séances d’improvisation jazz[2]. Les structures sont ici des pistes de lecture. Le lecteur délaisse son rôle passif d’auditeur pour devenir musicien : il doit interpréter la partition et choisir un chemin.
« Une géographie de la page »
La typographie est un véritable voyage et Michel Butor risque l’aventure. La boîte à outils[3] de la typographie est constituée d’une multitude d’éléments et Butor, qui favorise une mise en page simple, l’utilise efficacement. Il fait l’inventaire des possibilités qui s’offre à lui : polices de caractères, regroupement des corps et graisse, alinéas, blancs, annotations, coupures du texte et cadrages qui en résultent. Les marges proposent une panoplie de possibilités. Butor utilise dans Mobile cinq marges différentes créant plusieurs degrés de lecture. Le titre courant est un autre élément polyphonique utilisé par l’auteur. Tous ces éléments modulent le texte et le mettent en mouvement à tel point que Butor ne parle plus de blanc « […], mais de gris typographique ».
Sa stratégie est simple : maximiser l’effet en minimisant les coûts. Il faut utiliser les ressources « gigantesques » de la typographie le plus habilement possible afin de permettre une plus grande variété tout réduisant les coûts pour l’éditeur. Cette économie de moyens il l’obtient en utilisant : « […] uniquement un caractère, dans un seul corps, mais avec ses variétés classiques telles que grandes capitales, petites capitales, minuscules et italiques… c’est tout ! ».
Cette organisation du texte, ce jeu sur la matérialité du livre, donne « […] tout un champ de possibilité de lecture ». Les codes graphiques varient d’un genre à l’autre. Différentes techniques et structures produisent différents sens et différentes lectures.
En avant la musique !
Si les structures mises en place par Butor remettent en questions nos habitudes de lecture, elles permettent également de recadrer les modes de fabrication du livre et les choix éditoriaux qui les façonnent. Butor se penche sur la problématique de la dépendance de l’auteur par rapport aux modes de production et les difficultés d’autonomisation vécues au début des années 70. Évidemment, les choses ont bien changé. Les développements technologiques et l’apparition du livre électronique permettent aujourd’hui une plus grande flexibilité de création.
Nous avons, presque à notre insu, glissé dans le monde de possibilités dont rêvait Michel Butor :
Je rêve de pouvoir utiliser bien mieux cet “orchestre” dans lequel chaque caractère a un timbre, exactement comme un instrument de musique. À ce moment-là, des caractères nouveaux pourraient introduire des instruments nouveaux, des sentiments nouveaux, comme les instruments de musique le font dans l’orchestration.
Daniel Dugas 12 février 2013
![]() PDF (217kb)
PDF (217kb)
[1] Salvador Dali crée en 1931 les objets à fonctionnement symbolique en assemblant des objets entre eux. Ce faisant, il invente un type nouveau d’objet, irrationnel et doté d’un mécanisme de révélation de l’inconscient venant « concurrencer l’objet utile et pratique ». Le Musée de l’Objet – collection d’art contemporain. http://www.museedelobjet.org/presentation.html [en ligne] consulté le 10 février 2013
[2] Il serait intéressant de voir les corrélations entre les techniques utilisées par Butor et le soundpainting, un langage de gestes multidisciplinaire crée par Walter Thompson en 1974. http://www.soundpainting.com/home-2-fr/ [en ligne], consulté le 10 février 2013.
[3] Étymol. et Hist.1. Début du xiies. ustilz «équipement, objets nécessaires qu’on embarque pour un voyage» (S. Brendan, éd. I. Short et Br. Merrilees, 179) […] http://www.cnrtl.fr/etymologie/outil [en ligne], consulté le 10 février 2013.
Hé ! suivi de Icônes (2010)
J’ai un nouveau recueil de poésie qui va être publié aux Éditions Prise de parole. Le livre sera lancé lors du Salon du livre du Grand Sudbury, Ontario au début mai 2010.
Hé ! suivi de Icônes de Daniel Dugas est un combat bien mené entre l’état d’un monde à la fois dépourvu de sens et, paradoxalement, débordant de créations destinées à interpeller les sens. Quelle place alors pour l’émerveillement, cette qualité première que l’on trouve chez l’enfant mais qui, à l’âge adulte, est pollué, difficile à trouver, forcé même parfois parmi tant de désabusements ? Heureusement, il y a ces restes d’exclamations, spontanées, imprévisibles, qui prennent l’adulte au dépourvu. Quand, justement, se glissent l’innocente surprise, le bonheur sporadique, le rêve battant, que pointe l’espoir en étincelle…
Même un détour serait correct (2006)
Même un détour serait correct est animé par la révolte contre le pouvoir sauvage. Les vers y oscillent entre la dénonciation impuissante et l’espoir calculé. Un « refus global » prononcé avec émotion, qui aménage ponts et possibilités permettant à l’homme de « traverser de l’autre côté ».
Quel est le rôle de l’avant-garde en arts visuels en Acadie? (1999)
Quel est le rôle de l’avant-garde en arts visuels en Acadie?
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire sur le rôle de l’avant-garde en Acadie, ma première réaction n’a pas été des plus enthousiastes. Le terme avant-garde est un mot fourre-tout où se retrouve à peu près n’importe quoi. Du salon de coiffure avant-garde à l’avant-garde russe, il y en a pour tous les goûts.
Alors j’ai dû me poser la question de savoir, non pas quel est le rôle de l’avant-garde en Acadie, mais bien si l’avant-garde existait encore et si elle pouvait exister ici. Laissez-moi vous dire ce que j’ai trouvé: “Ils sont le plus souvent pendus, roués de coups, mis aux piloris, ou condamnés à divers supplices.”
C’est ainsi que Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, parlait des prophètes. On pourrait en dire presque autant des artistes de l’avant-garde, car les deux font un peu le même métier. Tous les deux sont des tranches-montagnes sans égal.
Ils courent en ligne droite, devancent le Temps, et après avoir gagné quelques mètres d’avance, ils se retournent rapidement et font, à ce Temps inexorable, un pied de nez magistral. Mais voilà, les artistes de l’avant-garde sont le plus souvent ignorés et laissés à eux-mêmes. L’abandon est leur supplice. On a bien dit de Jeff Koon qu’il était the last bit of methane in the intestine of the dead cow of post-modernism [1] , mais en général le désintéressement est presque de rigueur.
L’avant-garde à bout de souffle
Il est impossible de parler de l’avant-garde sans parler du courant dominant – du mainstream – (est-ce à dire que le public est dominé?). Ce courant, qui nous traverse de toutes parts, aime bien l’homogénéité et la rareté d’alternatives. L’avant-garde, elle, se plaît à trouver de nouveaux sentiers, elle explore et quelquefois elle s’égare, et avec elle son public. Elle est souvent difficile à saisir parce qu’elle exige un regard critique. La plupart d’entre nous allons au cinéma ou à la galerie d’art pour nous divertir. L’avant-garde interroge. Pendant que Céline Dion cash in, Yvonne Rainer pose des questions. C’est comme ça…
L’artiste d’avant-garde a été une sorte de prophète des temps modernes. Il fut l’audace même, le précurseur, l’annonciateur qui prépare la venue. Il a souvent été téméraire, arrogant, impertinent, insolent et sans gêne. L’avant-garde a été, au fil de notre siècle, Russe, dada, surréaliste, Léttriste, SI, IMIB, Cobra, Fluxus, néo géo, etc.
Le prophète et l’artiste d’avant-garde, parce qu’il sont en avance sur leur temps, ne peuvent que prétendre jouer le rôle de précurseurs. Ce qu’ils annoncent n’est pas encore là pour leur donner raison. Le Temps est l’outil avec lequel ils fabriquent leur oeuvre et le Temps est devenu un outil de paradoxe. Si le mouvement artistique d’avant-garde s’inscrit dans le XXe siècle, il est au seuil du second millénaire, à bout de souffle et semble manquer de cette pertinence qui fut pendant si longtemps son fer de lance.
Cette perte est attribuable à un fait fondamental : Le Temps s’est dérobé sous ses pieds. L’avant-garde se bute à une élasticité temporelle qui caractérise notre époque. Car comment prédire, comment être le précurseur de n’importe quoi lorsque l’ère dans laquelle nous vivons est un melting pot de toutes les époques?
Dans les revivals des années 50, 60, 70 et bientôt 80, qu’est-ce que le futur sinon des réalités de plus en plus virtuelles, de plus en plus floues et sans attache. La vitesse à laquelle la publicité, par exemple, récupère tout ce qui est nouveau, tout ce qui est audacieux, rend l’audace moins imprudente qu’elle le semblait dans les décennies précédentes.
C’est une époque où les décorateurs de bureaux sont devenus des conservateurs d’art. Avec la chute du mur de Berlin et de l’Union Soviétique, l’avant-garde n’a cessé de glisser sur une peau de banane historique.
Une paralysie de l’audace
Nous vivons maintenant dans une ère où la réussite est tellement importante, ou le besoin d’approbation est tellement fort, qu’il s’est créé une espèce de paralysie de l’audace. Il existe des artistes en début de carrières qui parlent de la peur de commettre des erreurs. C’est aberrant. L’avant-garde est morte il n’existe que de l’art actuel, de l’art d’aujourd’hui.
C’est dans l’art contemporain que les gestes de création extraordinaires existent, ici comme ailleurs, mais comme tout, ils sont de plus en plus guidés par cet esprit d’entreprise, de stratégie et de plan d’affaires. L’art d’avant-garde n’existe plus parce que le Temps est devenu mou et ne peut plus être devancé. Il n’existe que deux choses : l’art contemporain et le folklore. Et ce qui n’est pas actuel est nécessairement nostalgique.
En Acadie les deux coexistent de façon pacifique sans faire de remous, paisiblement. L’un regarde aujourd’hui et l’autre se rappelle d’avoir vu.
L’eau qui stagne est la première à geler
La vraie question donc, est de savoir quel est le rôle de l’art contemporain en Acadie ou si la possibilité de prendre des risques existe encore pour les artistes acadiens. Malgré des limitations évidentes à plusieurs niveaux – le NB et l’I-P-E sont les seules provinces au Canada à ne pas avoir de centre de production vidéo géré par des artistes, quoique la galerie Struts de Sackville vient de créer récemment la structure de leur nouveau Media Centre mais il reste encore beaucoup à faire avant que les artistes puissent y créer – il y a ici des communautés artistiques talentueuses et il existe quelques institutions qui devraient être capables d’infuser aux artistes ce désir de repousser un peu plus loin la frontière du connu et de l’inconnu.
L’art acadien ne fonctionne pas en vase clos, il ne peut que s’insérer dans un discours qui s’articule à l’échelle mondiale. Et pour être effectif, l’art acadien doit défier les conventions, tabasser les traditions et questionner les gestes et les rêves de la société et de l’individu.
[1] Attribué à l’ écrivain et historien d’art d’origine australienne Robert Hughes.
*
L’auteur est artiste pluridisciplinaire et enseignant à l’Université de Moncton.
Publié: publié dans le Ven’d’est, numéro 82, janvier 1999, pp 29 – 31
La limite élastique (1998)
Avec les mots et les chansons d’une époque hédoniste, Daniel Dugas peint le portrait d’une société où l’artificiel est tellement généralisé qu’il fait partie intégrale du paysage. Dans La Limite élastique, un style ironique et humoristique contraste avec le destin tragique de l’humain tel que Dugas le peint. À la fois séduisante et trouble, la poésie de Daniel Dugas est de la plus grande actualité.
Lis-moi l’avenir
lis-moi l’avenir dans les grains d’avoines
dans les silos
dans l’Ouest
lis-moi l’avenir dans les feuilles de thé
dans le mac de café
lis-moi l’avenir
dans les nuances des couleurs
qui dansent
dans les pots des vidanges d’huile
lis-moi la peinture des maisons
qui s’écaillent
et qui sèchent au soleil
lis-moi dans les cendres des feux de forêt
dans les bouts de bois
que les charpentiers laissent
derrière eux
quand ils construisent des maisons
lis-moi l’avenir
dans le bruit des lignes électriques
qui emmène le courant là où on en demande
lis-moi l’avenir dans les sauts des animaux
qui meurent sur les routes
lis-moi l’avenir dans la nuit
qui est noire comme du charbon
lis dans la poussière
dans les livres de recettes
et dans les secrets
lis l’avenir dans les embouteillages du matin
et ceux du soir
dans les changements technologiques
que la science nous donne
dans les puits asséchés
dans les marées
dans les bars dans l’odeur du Liquid Paper
lis-moi l’avenir
quand l’inspecteur de police
parle aux médias d’une situation tendue
quelque part au pays
lis entre les lignes du slogan de Microsoft
“WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY”
dans les mosaïques de Pompeï
dans la musique militaire de Souza
lis-moi l’avenir et dis-moi lequel choisir
l’avaleur de sabre
l’avaleur de sable
ou l’avaleur de farine blanche
lis-moi l’avenir dans l’histoire du travail
dans l’importance de la poignée de main
dans la liberté
dans la fortune
et dans les conditions que lui impose le caractère
lis tout l’avenir possible dans les têtes de bronze des statues
lis dans les tempêtes dans les verres d’eau
écoute et dis-moi
ce que dit celui qui se noie dans un crachat
lis dans la canne de vers
qu’il ne faut pas ne pas l’ouvrir
lis-moi l’avenir du libre-marchée
du “UNDREPASS OF THE INFORMATION HIGHWAY”
Haradius Coclès dit le Borgne défendit seul l’entrée du pont Sublicius à Rome. Il permit aux siens de couper le pont derrière lui, puis s’échappa à la nage. Il perdit là un oeil, d’où son surnom.
lis-moi l’avenir
de la stupeur à la somnolence
de la confusion au coma profond
lis l’avenir dans la précession des équinoxes
lis l’avenir
quand l’aviron touche l’eau
et que l’eau embrasse la rame et que du canoë le lac
semble être un miroir
lis-moi dans l’avenir
qu’il est possible
que quelqu’un
dans le centre-ville de São Paulo
entende une épingle tomber
lis que tout ne doit pas être modelé
sur les publicités télévisées
ou le mauvais discours politique
lis-moi l’avenir
qu’il est possible d’apprendre
à coudre
d’apprendre à nager
d’apprendre à dessiner
d’apprendre à danser
d’apprendre à vivre
lis dans l’avenir
de ce qui dit être
résolument ouvert sur le monde
mais qui est en réalité
résolument ouvert à ce que les choses
restent comme elles sont
lis tout haut
que le saint qui a donné tous ses vêtements
ne comprends rien au phénomène “Walmart”
je dis que la révolution ne veut plus rien dire
et que c’est absurde
d’aimer la musique arabe
tout en détestant l’orthodoxie musulmane
Emmanuel Bianco s’est enfoncé un pieux dans l’abdomen, il s’est coupé la gorge et s’est déchiqueté les chairs avec un rasoir. Inondé de sang il s’est brûlé la langue avec un couteau chauffé à blanc et dans le silence de sa chambre il s’est écroulé dans un lac de sang qu’il nomma avant de mourir le lac rouge.
Emmanuel Bianco était un moraliste.
lis-moi l’avenir dans la sueur des boxeurs
dans le degré de réalisme qu’il faudra atteindre
avant de pleurer
lis dans la mission
lis dans l’intermission des marchands
qui sont devenus des idoles et des stars
qu’il faut développer le monde
lis-moi dans les infrastructures touristiques
dans les trous que les vers font dans les pommes
dans l’ombre de la tranquillité
des trous que les vers ont faits dans les pommes
lis-moi l’avenir dans l’intonation des encanteurs
dans les yeux de ceux qui pour une récompense
sont prêts à dénoncer même les plus petits criminels
Un homme dont le nom n’est dans aucun dictionnaire
s’avance dans une pièce et regarde l’audience
Il est décontracté
Il est cool
On a l’impression qu’il s’avance pour longtemps
Il met ses mains dans ses poches
et fait tourner la monnaie encore et encore
et chaque fois le bruit est merveilleux
et cet homme dans le bruit de l’argent qui tourne
tourne aussi Il s’arrête
Il regarde
Le monde est un origami qu’il déplie
Il dit :
J’AIME L’ÉCONOMIE DU LIBRE-MARCHÉ.
ET VOUS?
lis dans l’avenir qui fait le pain
et qui invente la liberté
lis qu’il faut manger
lis dans l’avenir et apporte la définition d’être un GO-GETTER
quand on est devant la mer
et que le ciel et l’eau se mélangent à tel point
qu’il n’est plus possible de discerner aucun horizon
lis dans la pointe du cap
dans la nuit
quand le vertige s’empare de tout
et qu’il faut faire quelque chose
qu’il faut tenter de croire à autre chose qu’au désordre
lis dans l’avenir par les toutes petites fenêtres du grand building
dans la ville qui est une fourmilière
dans le ballet des automobilistes
qui tournent en rond dans le stationnement
dans les arbres verts
dans les rivières
lis par les petites fenêtres
qui ne s’ouvrent
que par leur transparence
lis qu’il est écrit qu’il faut s’acquitter de la liberté du monde
lis moi l’avenir d’être visible
lis moi l’avenir dans la sottise
et aussi dans la raison
qui pousse les banquiers à agir comme ils le font
dans l’avarice et dans les humeurs
dans les amis de Villon
qui sont partis du pas de sa porte
emportés par le vent
lis l’avenir dans la fragilité du monde
dans la lumière qui entoure chaque avion dans le ciel
entre deux villes
chaque enfant
entre deux gifles
lis-moi l’avenir dans le fruit du travail
qui est souvent pourri
lis-moi l’avenir dans le bruit des talons
dans les corridors des institutions
où le granite est un autel
où le savon industriel est le sang des sacrifices
où chaque prisonnier
est le gardien de sa propre peine
dans le silence de l’institution
je me tiens debout
je marche au-dessus du granite
et je souhaite la nature
j’ouvre une porte
et par la fenêtre
je vois une autre institution
où rêve sûrement
un autre ouvrier
un autre concierge
Il me voit
et il me parle
je lis avec difficulté mais je lis sur ses lèvres
Il dit :
“Le bout du monde est une pièce éclairée par une simple ampoule, et quand les rêves s’éteignent c’est d’avoir atteint la limite du monde.”
il s’arrête
nous nous regardons longtemps
je me souviens d’avoir souhaité qu’il sache nager
Read me the Future
read me the future in the grains of oats
in the silos
in the West
read me the future in the tea leaves
in the coffee grinds
read me the future
in the nuances of colour
which dance
in the buckets of used oil
read me the future in the house paint
which blisters and dries in the sun
read me the future in the ashes of forest fires
in the scraps of wood
which carpenters leave behind them
when they build houses
read me the future
in the noise of electric lines
which carry the current to the places where it is needed
read me the future in the leaps of animals
who die on the road
read me the future in the night
that is black as coal
read in the dust
in recipe books
and in the secrets
read me the future in the morning traffic jams
and those at night
in the technological changes
that science gives us
in the dry wells
in the marshes in the bars
in the smell of Liquid Paper
read me the future
when the police inspector
talks to the media in a tight situation
somewhere in the country
read between the lines of the Microsoft slogan
‘WHERE DO YOU WANT TO GO TODAY?’
in the mosaics of Pompei
in the music of Souza
read me the future and tell me which to choose
the sword-swallower
or the sand swallower
or the swallower of white flour
read me the future in the history of work
in the importance of the fist
in freedom
in fortune
and in the conditions which form character
read me all of the futures possible in the heads of bronze statues
read in the tempests in the glasses of water
listen and tell me
what is being said by the one who is drowning in spit
read me in the can of worms
that you cannot but open
read me the future of the free market and the ‘UNDERPASS OF THE INFORMATION HIGHWAY’
The one-eyed Haradius Coclès a.k.a. Le Borgne, is said to have single-handedly defended the entrance of the Sublicius Bridge into Rome. This allowed his people to cut the bridge behind him, he then escaped by swimming. He lost an eye and gained his nickname.
read me the future
between stupor and drowsiness
between confusion and deep coma
read the future in the movement of the equinox
read the future
when the oar touches the water
so that the water embraces the oar
and from the canoe the lake
seems like a mirror
read me in the future
that it is possible
that someone
in downtown Sao-Paolo
can hear a pin drop
tell me that everything cannot be modeled from televised broadcasts
or poor political discourse
read me the future
that it is possible to learn
to sew
to swim
to draw
to dance
to live
read in the future
that which is said to be
absolutely open to the world
but is in reality
totally open
to that things remain as they are
read aloud
that the saint who has given away all of his clothes
understands nothing of the phenomenon ‘Walmart’
I say that the revolution does not mean anything
anymore
and that it is absurd
to love Arab music
while detesting Muslim orthodoxy
Emmanuel Bianco drove a stake into his abdomen, he cut his throat and tore his flesh ragged with a razor. Covered in blood, he burned his tongue with a white-hot knife and in the silence of his room, he fell into a lake of blood which he named Red Lake before dying. Emmanuel Bianco was a moralist.
read me the future in the sweat of boxers
in the degree of realism which must be attained
before crying
read in the mission
read in the intermission of merchants
who have become the idols and the stars
that the world must be developed
read in the touristic infrastructures
in the holes that worms make in apples
in the shadows of the tranquility
of the holes that the worms have made in the apples
read me the future in the intonation of auctioneers
in the eyes of those who
for a reward
are ready to denounce even petty criminals
A man whose name is not in any dictionary
steps forward on a stage and looks at his audience
he is laid-back
he is cool
we have the impression that he has been moving forward for a long time
he puts his hands in his pockets
and turns the loose change
over and over
and each time the noise is wonderful
and in the noise of the money turning
this man also turns
he stops
he looks
the world is an origami that he unfolds
he says: ‘I like the free-market economy, and you?’
read in the future
who makes the bread
and who invents freedom
read that one has to eat
read in the future and bring the definition of being a GO-GETTER
when one is in front of the sea
and the sky and the water become so blended
that it is no longer possible to discern the horizon
read in the tip of the cape
in the night
when the vertigo takes over
and it is necessary to do something
that you have to believe
that there are things other than disorder
read in the future by all of the little windows in a big building
in the city that is an anthill in the ballet of automobiles
which make circles in the parking lot
in the green trees
in the rivers
read by the little windows
which do not open
except by their transparence
read that it is written
that you have to discharge yourself from the liberty of the world
read me the future of being visible
read me the future in the silliness
and in the reason
that pushes the bankers to act as they do
in the greed and in the moods
in the friends of Villon
who have gone by the threshold of his door
carried by the wind
read in the fragility of the world
in the light which wraps each airplane in the sky
between two cities
each child
between each slap in the face
read me the future in the fruit of work
which is often rotten
read me the future in the noise of the high heels
in the corridors of institutions
where the granite is an altar
where the industrial soap is the blood of sacrifices
where each prisoner is the guardian of his own sentence
in the silence of the institution
I stand up
I walk above the granite
and I wish nature
I open a door
and by a window
I see another institution
where maybe
another worker
another janitor
also dreams
he sees me
and he talks to me
I read with difficulty but I read on his lips he says:
‘The end of the world is a room lit by a single light bulb, and when the dreams go out it is to have reached the limit of the world.’
We look at each other for a long time
I remember to have wished that he knew how to swim
Translation : Valerie LeBlanc
From : La limite élastique, 84 pp.
Published in 1998 by Les Éditions Perce-Neige22-140, Botsford
Moncton, NBE1C 4X4
Daniel H. Dugas
Archives
Blogroll
- A.I.R. Vallauris
- ACAD
- Adobe additional services
- Adobe Creative Cloud
- AIRIE
- Amaas
- Amazon Author Central
- ARTothèque
- Australian Poetry
- Basic Bruegel
- Bitly
- CCCA
- CDBaby
- Cycling 74
- Dissolution
- Éditions Prise de parole
- Emmedia
- eyelevelgallery
- FAVA
- Festival acadien de poésie
- Festival FRYE Festival
- FILE – Electronic Language International Festival
- Freeware list
- Fringe Online
- Galerie Sans Nom
- Gotta Minute Film Festival
- Instants Vidéo
- JUiCYHEADS
- Kindle Direct Publishing
- Klondike Institute of Art and Culture
- La Maison de la poésie de Montréal
- La Maison de la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles
- Laboratorio Arte-Alameda
- Le Centre Jacques Cartier
- Liberated Words
- Maison Internationale de la Poésie – Arthur Haulot
- MediaPackBoard
- Miami Book Fair International
- Monoskop
- Mot Dit
- NSCAD University
- Paved Arts
- PoetryFilm
- Portail des auteurs du Nouveau-Brunswick
- RECF
- Revue Ancrages
- Salon du Livre du Grand Sudbury
- Sculpture Space
- Subtropics.org
- Sydney college for the arts
- The Centre for Contemporary Canadian Art
- The New Gallery
- Trevigliopoesia
- tumbler-documents
- V Tape
- Valerie LeBlanc
- VideoBardo
- Void Network-Κενο Δίκτυο
Categories
- #covidpoèmes
- Advertisement
- AIRIE
- Ancrages
- anthology
- Anthropocene
- Architecture
- Around Osprey
- art
- Article de presse
- arts visuels
- audio
- Australian Poetry
- Basic Bruegel Editions
- Book
- book fair
- Cafe Poet Program
- Ce qu'on emporte avec nous
- Citations gratuites
- Collaboration
- commentaire
- commentary
- Compte rendu
- conférence
- Conservation Foundation of the Gulf Coast
- COVID-19
- Critique littéraire
- culture
- Daniel Dugas
- Design
- Édition Michel-Henri
- Éditions Perce-Neige
- Éloizes
- Emmedia
- emoji etc | émoji etc
- Environnement
- essai
- essay
- Everglades
- Exhibition
- festival
- Festival acadien de poésie
- Festival Frye Festival
- FIPTR
- Flow: Big Waters
- Fundy
- Habitat
- installation
- Instants Vidéo
- interactivity
- journal
- JUiCYHEADS
- Kisii
- L'Esprit du temps
- laptop
- Leaving São Paulo
- lecture
- Livre
- logos
- Magazine
- Miami Book Fair
- Moncton 24
- novel
- OASIS
- oil spill
- perception
- performance
- Photo
- poésie
- Poetic Licence Week
- Poetry
- politics
- politique
- press
- Prise de parole
- Revue Ancrages
- salon du livre
- sculpture
- Sculpture Space
- sound
- Souvenirs
- Spirit of the Time
- Style & Artifacts
- Symposium d'art/nature
- talk
- television
- The New Gallery
- Uncategorized
- Valerie LeBlanc
- vidéo
- vidéopoésie
- Videopoetr/Vidéopoésie
- videopoetry
- visual arts
- What We Take With Us
- youth literature